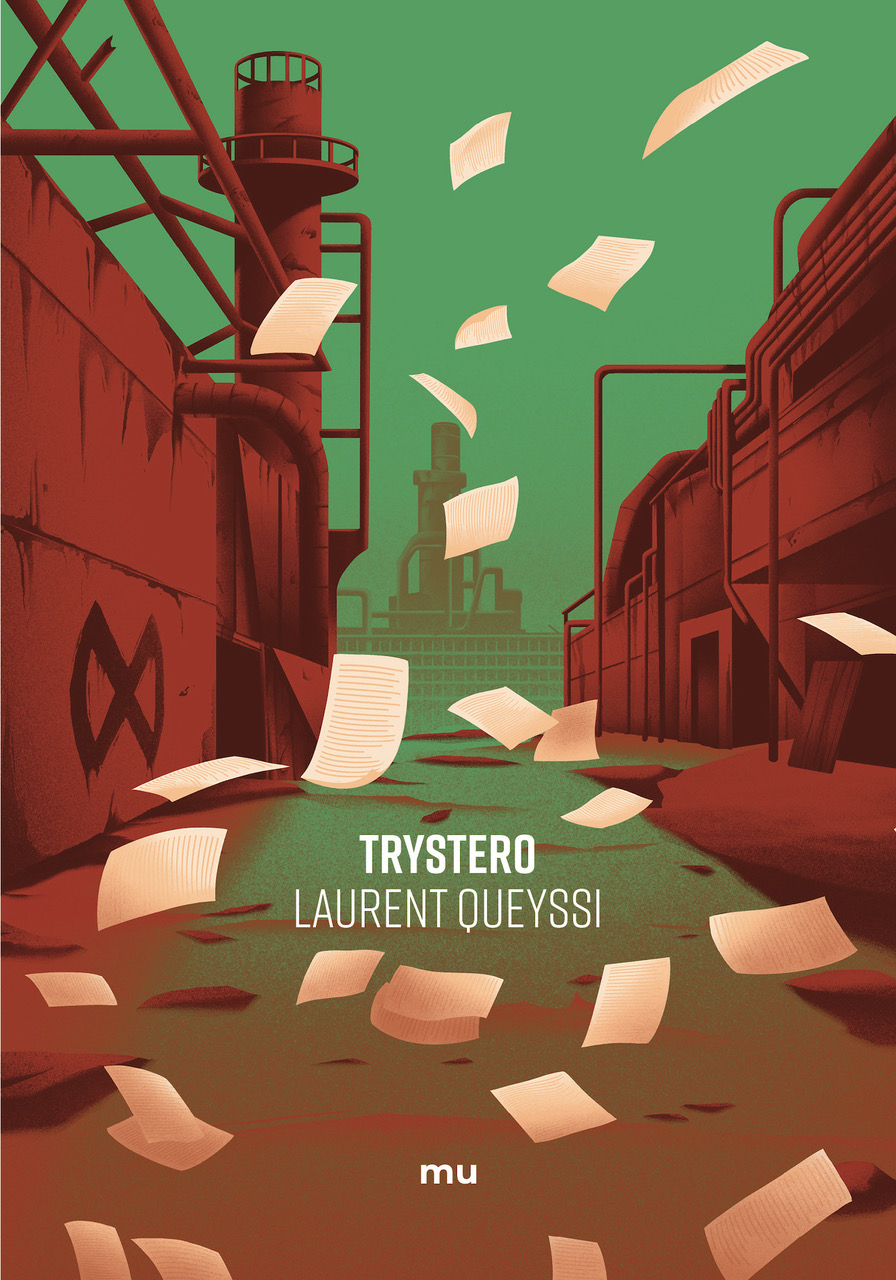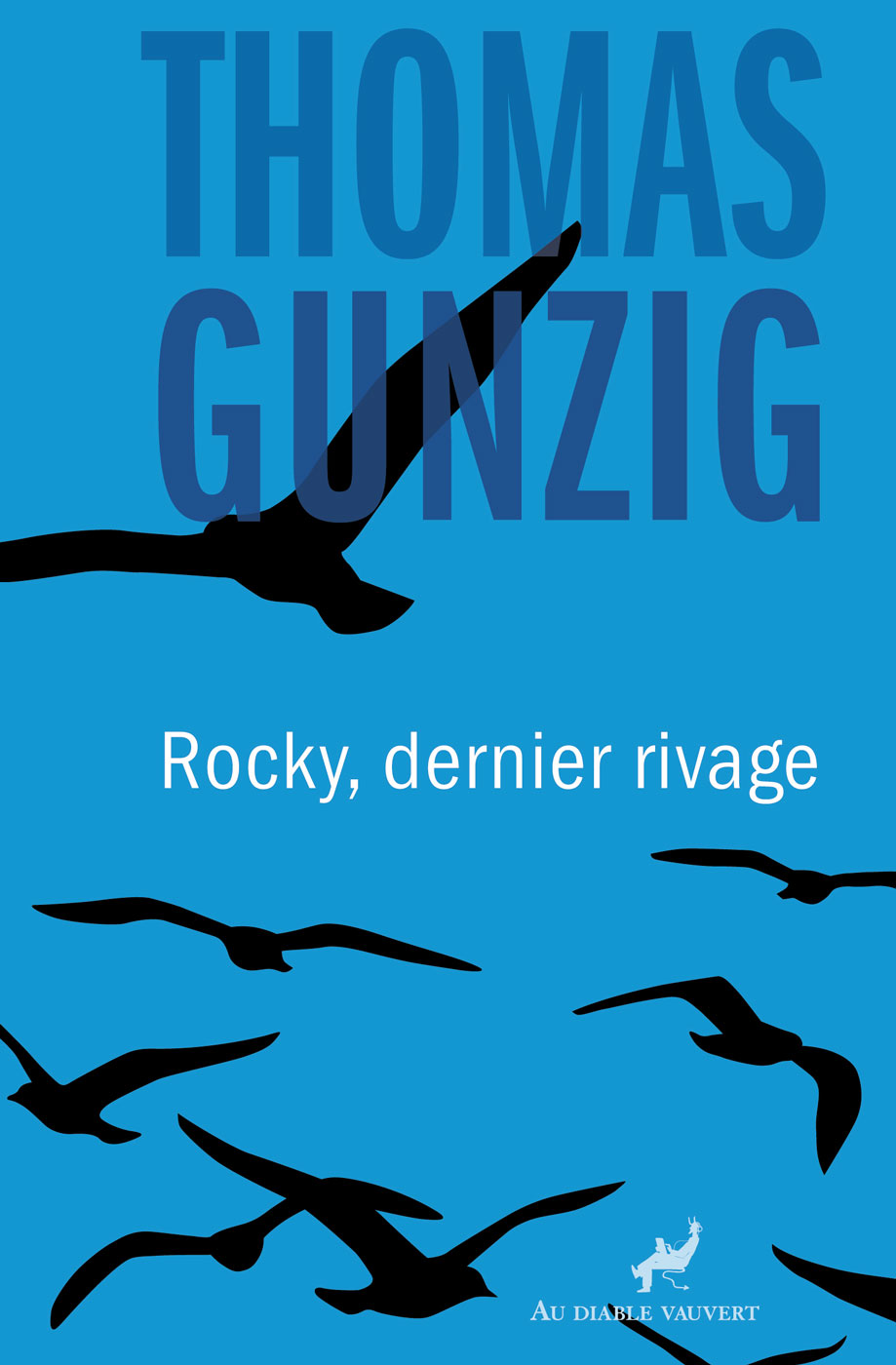Jérusalem
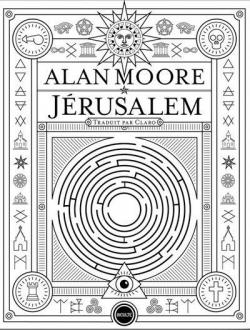
Jérusalem... À croire qu'Alan Moore a choisi le nom parfait pour écrire un évangile. La Sainte Bible selon Alma Warren...
Il est difficile de trouver les mots pour parler de Jérusalem. Ce livre n'usurpe pas son qualificatif de “monument”.
Jérusalem est un... roman ?... colossal, divisé en 3 parties, chacune rattachée à un aspect particulier des Boroughs, ce quartier de Northampton, ville natale de l'auteur, auquel il rend ici le plus parfait des hommages.
Chaque partie comporte 11 chapitres, chacun raconté du point de vue d'un protagoniste particulier, le tout formant un récit choral, parcourant plus de 1000 ans d'histoire dans le monde réel aussi bien que l'au-delà.
En effet, Jérusalem fait fi de la linéarité. Le temps se perd, les époques s’entremêlent, les vivants croisent les morts. L'Histoire prend forme au fil des déambulations.
Quelques repères existent, notamment la famille Vernall dont on suivra les membres sur 5 générations. Cependant, très rapidement, l'esprit s'égare, le fil se perd dans un méandre pour mieux se retrouver au détour d'une page, tissant peu à peu un univers entier, jusqu'à être pris de vertige devant les dimensions avec lesquelles l'auteur s'amuse.
Il semble en effet que chaque référence, chaque phrase, chaque mot soit choisi avec soin, et retrouve un écho à un moment ou à un autre du récit.
Face à cette oeuvre titanesque, à une écriture de bâtisseur, à un style inimitable, à des trouvailles lexicales inouïes, je ne peux que saluer le travail de traduction de Claro qui a su retranscrire la sublime poésie de ces textes, aussi exigeants que changeants.
Lire Jérusalem est une épreuve, un marathon intransigeant. On en ressort enrichi de mille choses, aussi instruit que humble.
Jérusalem | Alan Moore | Traduit par Claro | Inculte
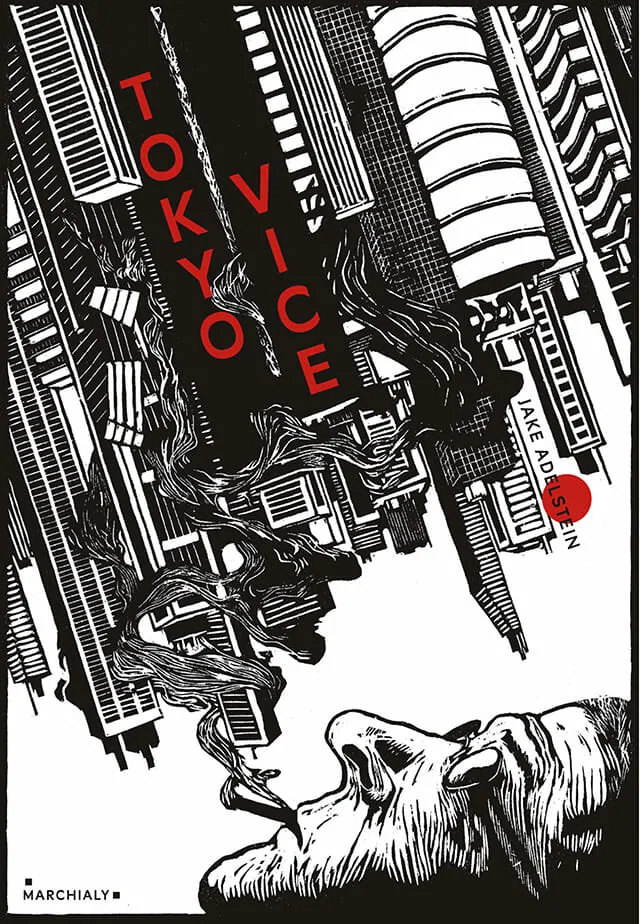
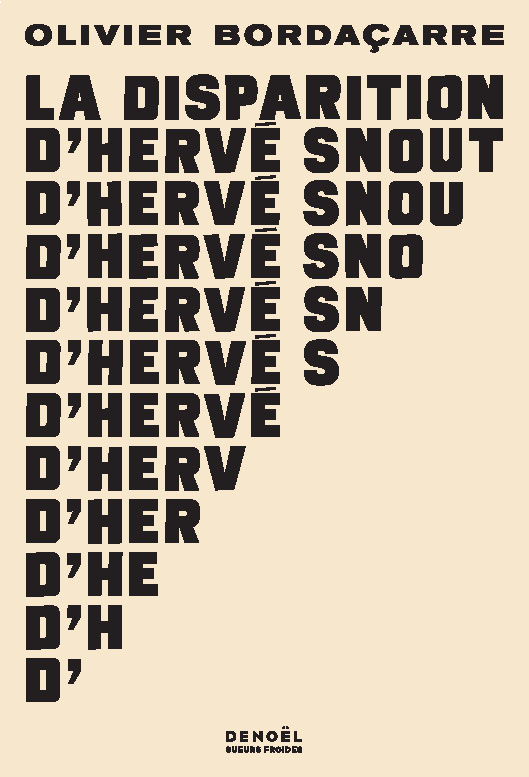



 Happée par la beauté surréaliste de ces images, je le fus aussi par ce monologue bouleversant, inspiré par le livre du même nom signé Olaf Stapledon. Ce dernier témoignage d'une humanité sur le point de s'éteindre, portant la sagesse de milliards d'années d'expérience. La voix absolument divine de Tilda Swinton creuse un peu plus l'aspect hypnotique du film.
Happée par la beauté surréaliste de ces images, je le fus aussi par ce monologue bouleversant, inspiré par le livre du même nom signé Olaf Stapledon. Ce dernier témoignage d'une humanité sur le point de s'éteindre, portant la sagesse de milliards d'années d'expérience. La voix absolument divine de Tilda Swinton creuse un peu plus l'aspect hypnotique du film.