Éoliennes, citoyen·es et dette démocratique
#Ecologie #Podcast Je viens d'écouter un nouvel épisode du podcast Chaleur humaine sur les éoliennes. Et c'était un très bon épisode, comme d'habitude 🙂. J'ai ressenti le besoin d'en faire un article de blog, et ce n'est pas pour partager quelques fun-facts sur les éoliennes ; quoi que, j'en ai quand même fait un premier paragraphe. C'est surtout parce que ce podcast m'a fait re réfléchir au conflit qu'on a par ici sur la réforme de la gestion des déchets, et au lien entre démocratie et acceptabilité des projets dits écologiques.
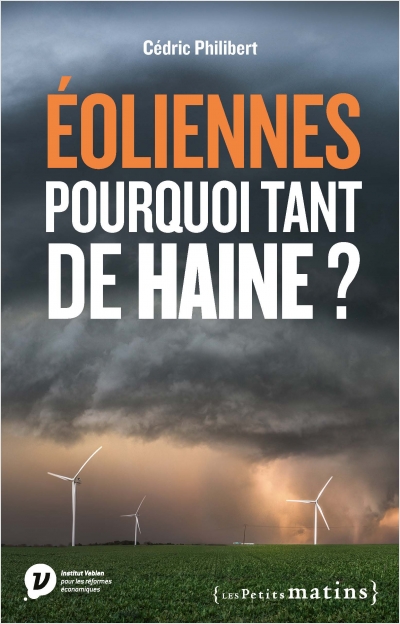
Miscellanées sur les éoliennes
J'ai donc appris plusieurs fun-facts sur les éoliennes. Je commence par ça parce que c'est facile et léger, mais ce n'est pas l'objet de ce post 😈.
- Les éoliennes produisent de l'énergie de manière contra-cyclique avec le solaire. C'est-à-dire qu'elles produisent surtout de l'énergie en hiver, et la nuit. Quand le solaire produit surtout de l'énergie l'été, et la journée. Donc ça se complète bien.
- On reproche aux éoliennes leur intermittence. Parfois il n'y a pas de vent. C'est vrai, surtout si on regarde la production d'un petit parc. Mais si on moyenne sur une région, ou sur un pays, ou même sur tout un système interconnecté (comme l'europe), alors les moments où il n'y a pas du tout d'énergie éolienne produite existent, mais ils sont rares.
- Les éoliennes produisent à leur capacité nominale sur une grande plage de vitesses de vent. Alors là, c'est un truc d'ingénieure, mais ça m'a plu. Une éolienne est une machine qui est optimisée pour tourner à une certaine vitesse. C'est à cette vitesse que le rendement est le meilleur, et là disons qu'elle produit 4 MW. Et bien l'éolienne est conçue pour atteindre 4 MW de puissance mettons dès que le vent souffle à 9 m/s. Et quand le vent souffle plus fort, elle tourne ses pales (comme l'hélice d'un avion à pas variable) pour produire toujours la même puissance. Et donc elle est dans un régime optimal pour une large palette de vents.
- En France, on a une des réglementations les plus restrictives pour l'implantation des éoliennes au regard des bases aériennes militaires et des radars. C'est un peu un fun fact, mais en fait ça limite réellement les zones où on peut implanter des éoliennes.
- Et le dernier point que je connaissais déjà, mais que ça fait toujours du bien de rappeler : oui les éoliennes tuent des oiseaux. Peut-être quelques milliers par an (je ne sais pas de quelle échelle géographique Cédric Philibert parle quand il dit ce nombre), mais pendant ce temps là, les pesticides ou le réchauffement climatique ou les baies vitrées vont tuer des millions d'oiseaux. En plus, on sait que financer ce genre d'**études qui sèment le doute **, c'est l'un des leviers des big corp (ici le pétrole) pour lutter contre le développement des énergies renouvelables.
Des éoliennes à la dette démocratique
Comme je le disais en intro, si j'ai voulu prendre le temps de faire cet article de blog, c'est surtout parce que ça m'a fait réfléchir sur les liens entre la démocratie locale et les grands projets écologiques.
Des citoyens qui râlent
Cédric Philibert évoque dans la conversation le fait que les éoliennes sont un cas typique de “Not In My Backyard”. Le fait que globalement on est pour, mais on n'en veut pas chez soi. Il poursuit en disant qu'il y a des cas de personnes qui râlent en disant que c'est moche ou que c'est bruyant. Et en effet, quand on subit quelque chose qu'on ne voulait pas, ça peut être vraiment stressant. Mais pour lui, ce sont souvent des manifestations du fait que quelque chose d'autres ne va pas.
Et ça m'a rappelé un chouette podcast de France Culture (produit en 2008, c'est un peu vintage), qui était allé interroger des habitant·es d'un parc éolien en Haute Loire. On ressentait très bien la douleur de certain·es habitant·es dont la colère s'était cristallisée autour de ces éoliennes. Le bruit était devenu une véritable source de stress. D'autres habitant·es pour lesquel·les ces éoliennes étaient source de revenu le vivaient au contraire très bien.
Cette réflexion fait écho à ce que l'on vit en ce moment sur mon territoire. Une réforme de la gestion des déchets qui modifie le mode de collecte fait beaucoup de mécontents. Pourtant, je ne pense pas que la réforme soit mauvaise, et je suis convaincue que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui contre pourraient être pour dans un autre contexte. Notre territoire a été particulièrement mobilisé au moment des manifestations des gilets jaunes. Ces manifestations, blocages de ronds points, ont montré une énorme insatisfaction, et il n'en est rien sorti. Macron a enterré les cahiers des doléances, et puis ça a été le confinement. On peut donc penser que chez nous, cette colère est toujours là. J'ai l'impression que cet épisode des déchets n'a fait que re-souffler sur les braises de cette insatisfaction, réelle et plus générale, des citoyen·nes de notre territoire.
- Lien vers un article où je parle du sujet et d'une visite que nous avons organisé avec le groupe local des verts.
- Lien vers le replay sur France TV du film les doléances qu'on aimerait projeter dans un évènement organisé par les écolos du coin.
Les projets écolo et la dette démocratique
Cédric Philibert explique que les projets qui marchent très bien sont ceux qui sont portés par des citoyen·nes. Ils et elles investissent un peu d'argent, décident ensemble de où les implanter, et bénéficient de l'argent généré.
Cette conversation m'en a évoqué une autre sur la dette démocratique. J'ai lu la première fois le mot de dette démocratique sous la plume de @n1k0 sur mastodon . Il en parlait en référence à la dette technique dans le monde du logiciel.
La dette technique c'est une expression qu'on utilise très couramment dans le monde du logiciel. En gros, pour gagner du temps, on écrit du code un peu crade. Quand il y a un bug, on crée un patch au lieu de réécrire une fonctionnalité. C'est un peu l'équivalent de mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça marche à court terme, mais ça ne résout pas le problème. Et puis un jour, ça nous pète à la gueule, et la seule solution, c'est de réécrire une grande partie du code depuis zéro. On est alors coincé·es pendant pas mal de temps avec un logiciel buggué le temps qu'une nouvelle version sorte. Je connais bien ce concept car je l'ai plusieurs fois vécu dans ma vie pro.
Bref, @N1k0 prend cet exemple pour faire une analogie avec la vie politique. Il est possible (et plus rapide) de prendre des décisions sans impliquer les personnes concernées, en général les citoyen·nes. C'est un peu l'idée de la phrase de Nelson Mandela : Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi.
Souvent, dans les grands projets du type “installation d'un parc d'éoliennes”, ou “réforme de la gestion des déchets”, il y a une phase de consultation citoyenne. Mais cette phase est souvent limitée à de l'information, il y a rarement beaucoup de négociations possibles. On est en général très loin du projet porté par les citoyens. Cela m'évoque deux réflexions :
- La consultation citoyenne avant le démarrage du projet va probablement beaucoup moins bien se passer sur un territoire qui souffre d'une forte dette démocratique. Si les citoyen·nes ont l'habitude que tout se fasse sans elleux, que lorsqu'on les consulte, c'est pour faire joli, alors il est normal qu'iels ne répondent pas vraiment présent·es lors des consultations citoyennes. Même si celles-ci étaient mieux organisées et avaient prévu de leur laisser une plus large place.
- Ici, les écologistes ont l'habitude de se positionner contre. Et c'est vrai qu'il y a des tas de projets contre lesquels il faut lutter. Mais comment favoriser l'émergence de projets pour lesquels on pourrait se battre ? Comment favoriser l'émergence de projets construits par et avec les citoyen·nes ?
Ce dernier point fait écho à un mouvement que je découvre (après tout le monde, comme d'habitude) : Le “ community organizing”, ou l'organisation collective en français. Ce mouvement s'inspire des travaux d'Alinsky, un sociologue qui a œuvré dans des quartiers noirs américains pour organiser des projets avec et pour les citoyens. Barack Obama a été un community organizer dans sa jeunesse et aurait construit sa campagne en en appliquant certains principes. Alexandria Ocasio-Cortez aurait aussi basé sa campagne sur les principes du community organizing.
Bref, j'en suis au stade où je découvre et où ça me fait envie car ça me donne un peu d'espoir 🙂. Je me demande s'il ne serait pas possible de faire germer des projets en suivant cette méthodologie pour se battre ensemble pour des projets locaux 💪 !