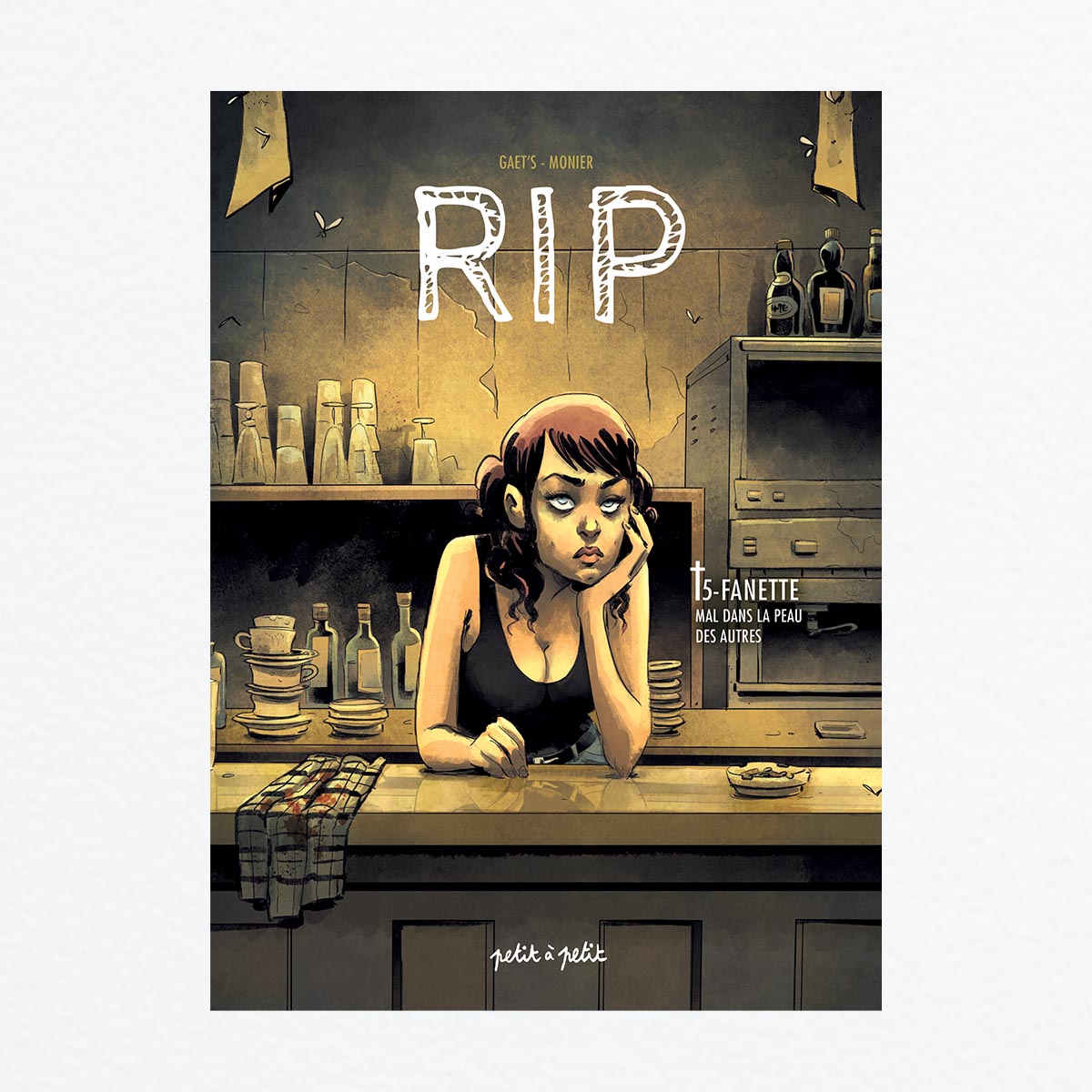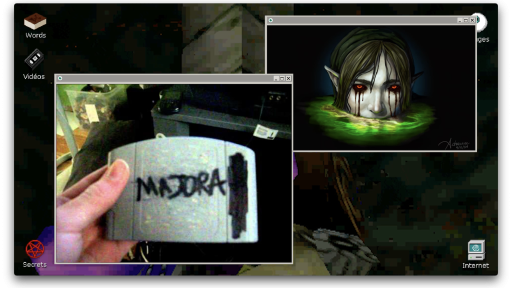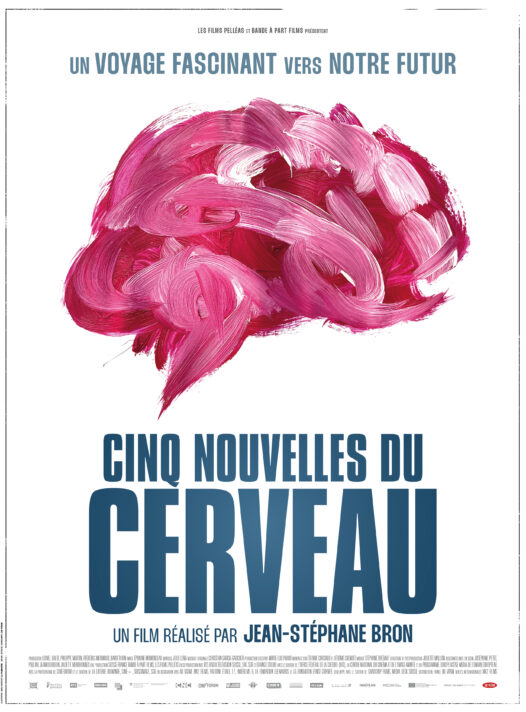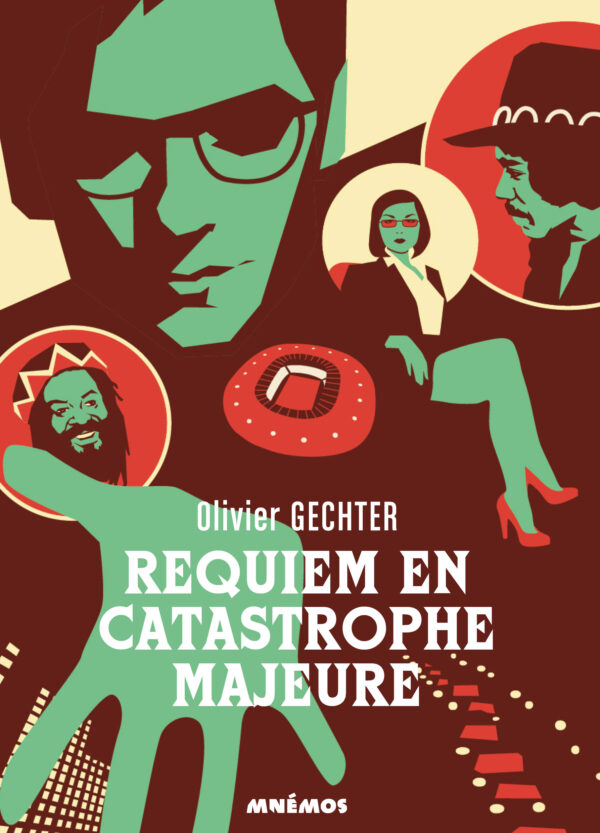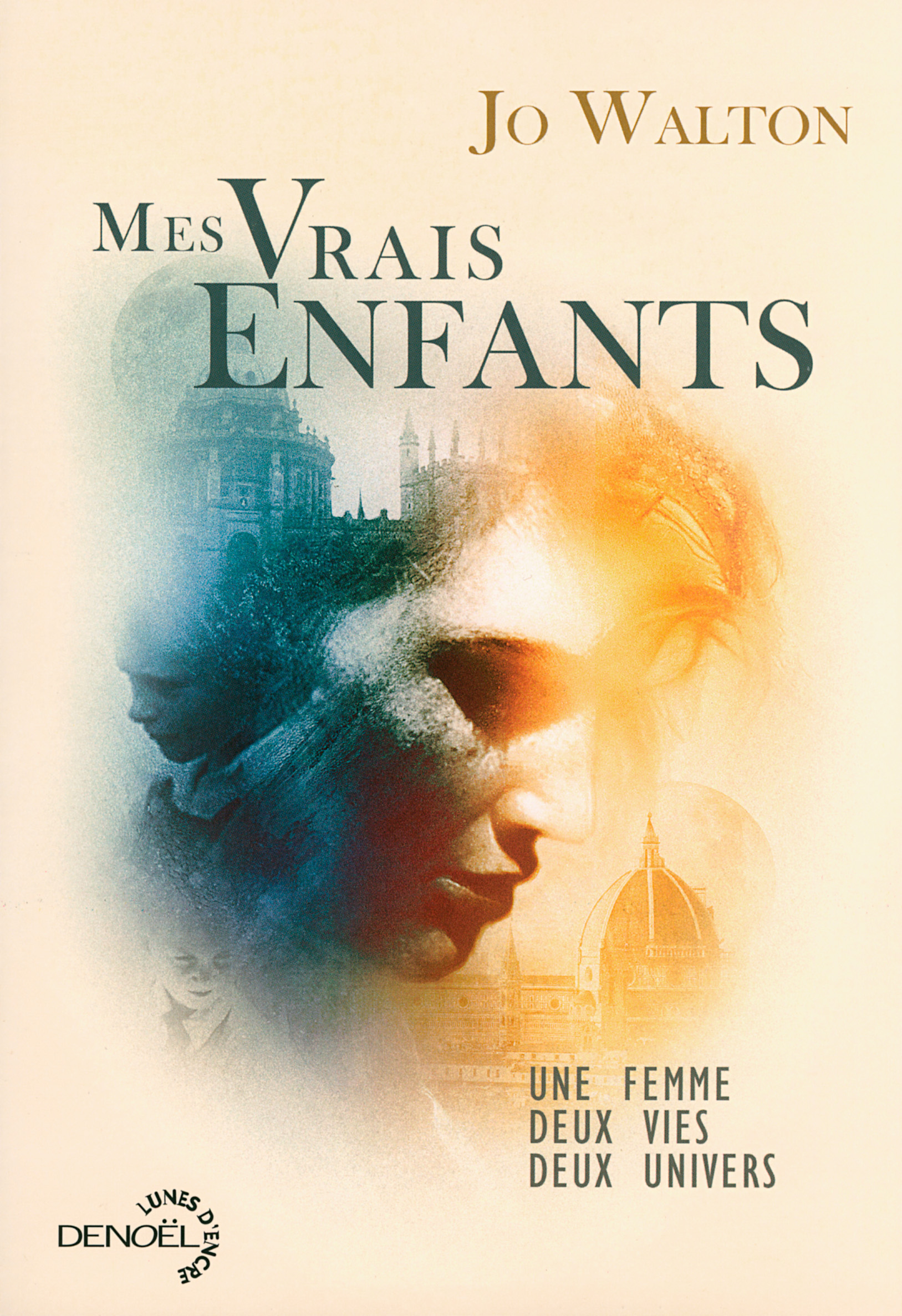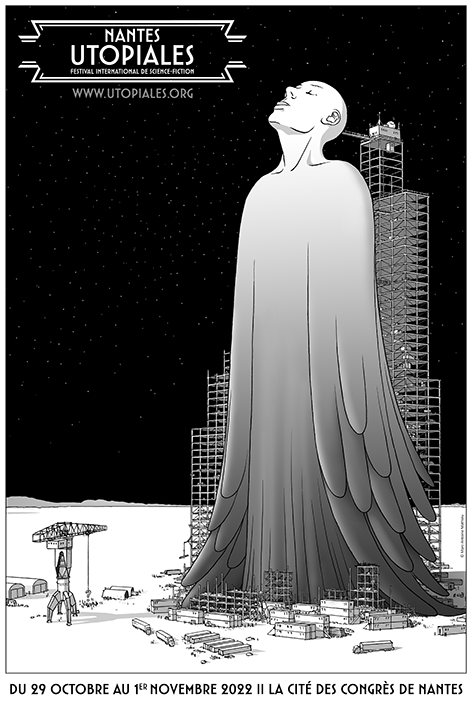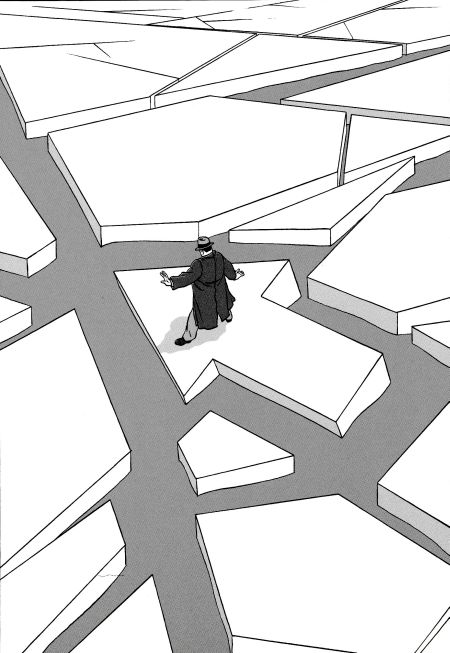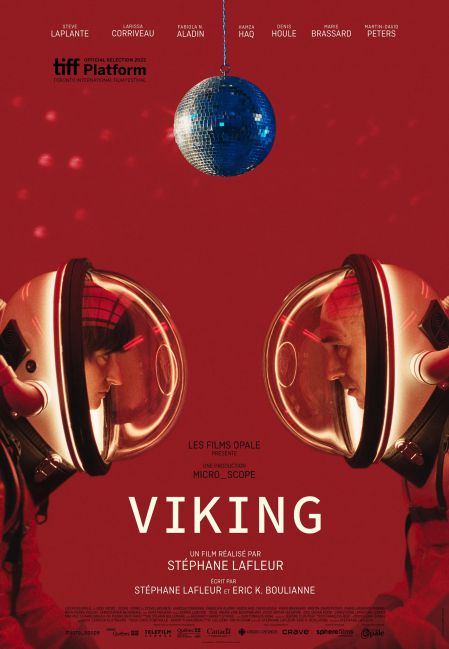C'est sur ces bases que le véritable débat s'engagea aussi à la fin 2015 : loin des polémiques s'installa une saine et légitime discussion entre historiens, journalistes et intellectuels. Quelle était l'utilité de publier une nouvelle traduction et une édition critique d'un livre pareil ? Quels en étaient les risques, quels en seraient les avantages ? Et surtout, pourquoi ce livre soulevait-il tant de questions ?
En ces temps troublés en ligne, s'il y a une chose que je dois concéder aux réseaux sociaux, c'est bien la lumière qu'ils m'ont permis de mettre sur un métier auquel je ne m'étais pas intéressé avant d'être blogueuse : la traduction littéraire. C'est en effet en côtoyant des personnes exerçant ce métier et en lisant les retours qu'elles font sur leur travail que j'ai commencé à me rendre compte de l'importance et de l'implication qu'il entraîne.
Olivier Mannoni fait partie de ceux-là. Traducteur de l'allemand, spécialisé dans les textes sur le IIIème Reich, c'est à lui que la maison d'édition Fayard s'adresse quand le projet d'une nouvelle édition de Mein Kampf voit le jour. Le projet de traduction évolue cependant, alors que, sous l'impulsion de l'historien Florent Brayard, nouveau directeur de publication, il lui est demandé, non pas de rendre le texte le plus compréhensible possible, mais plutôt de le rendre à son état d'origine : confus, parsemé de nombreuses fautes, redondances et incohérences, parfois quasiment illisible. Le texte sera alors publié accompagné d'un appareil critique très fourni, sans que son titre apparaisse.
Alors que l'ouvrage est paru en mai 2021 sous le titre Historiciser le mal, Olivier Mannoni revient dans ce court essai sur le long processus de traduction qu'il a demandé et sur les polémiques qui ont jalonné le projet.
Le cas de Mein Kampf ne pouvait être plus parfait pour mettre en avant le travail de traduction tant Olivier Mannoni réussi à nous faire comprendre à quel point le verbe, le style, les expressions d'Hitler sont utilisés pour faire passer ses idées abjectes par de nombreux procédés sémantiques. La traduction avait donc aussi pour enjeu de mettre à jour ces manigances qui se cachent pourtant dans la langue même. Le chemin fut long et éprouvant, et l'auteur évoque précisément les effets que ce travail a eus sur sa vie.
Alors, fallait-il rééditer Hitler ?
La polémique a enflé et l'auteur y répond parfaitement, avec mesure et justesse.
Oui, il fallait le faire.
Oui, il fallait se pencher sur les méthodes d'Hitler.
Oui, il fallait faire en sorte qu'il soit possible de comprendre, et de se souvenir.
En effet, alors qu'il évoque, dans la dernière partie de l'ouvrage, comment des échos lugubres à tout ceci se font de nouveau entendre de plus en plus, son analyse en est d'autant plus pertinente, quand les mêmes procédés rhétoriques semblent entraîner les mêmes effroyables conséquences.
Traduire Hitler est un ouvrage remarquable, aussi intelligent que juste. Le genre d'ouvrage qui réussit avec brio, en un peu plus de 100 pages, à enrichir le lecteur sur de nombreux sujets, éclairant le présent à la lumière de l'histoire.
Traduire Hitler | Olivier Mannoni | Héloïse d'Ormesson