Correspondant local
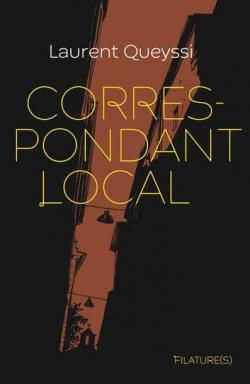
Même sous les arbres, sans un souffle d'air, la chaleur était quasi insupportable. On aurait dit qu'un rayon venu de l'espace avait tout figé, des feuilles sur les branches jusqu'à l'eau dans la fontaine hors service. La ville n'était pas morte, elle était statique, attendant l'ambre ou la lave qui la sauvegarderait pour l'éternité.
Cela fait des semaines, voir des mois que je n'avais pas lu un livre policier, après en avoir pourtant parcouru un bon nombre.
Il y a cependant peu de choses que je ne ferais pas pour Monsieur Laurent Queyssi, qui fut et reste :
- Un homme aux goûts sûrs dont j'ai suivi avec plaisir (et jamais aucune mauvaise surprise) beaucoup de recommandations de lecture (au hasard et j'en oublie : Michel Jeury, Robert Silverberg, Harlan Ellison, Paul DiFilippo ou Garth Ennis...)
- Un traducteur talentueux (son travail sur les textes de William Gibson est formidable !)
- Un écrivain dont j'apprécie beaucoup les textes (une fois pour toute, il faut lire Allison)
Il va donc sans dire que c'est avec un grand plaisir que j'ai entamé cette lecture. Je n'étais cependant pas conquise d'avance, tant je trouve le genre policier redondant et casse-gueule, mais assez intriguée par le choix du personnage principal, celui qui donne son nom au livre, le fameux correspondant local.
Un correspondant local, c'est cette personne qui, sans être journaliste, travaille pour la presse régionale en couvrant l'actualité locale. Celui qui est de toutes les rencontres sportives, de toutes les fêtes, de toutes les cérémonies. Celui qui connaît toutes les personnalités de sa ville, qui en maîtrise tous les rouages… Le personnage idéal, en fait, pour se retrouver au cœur d'une intrigue policière.
L'auteur a donc choisi de faire se dérouler son action dans un petit village du Sud-Ouest, figé par la chaleur dans des habitudes tranquilles qu'un meurtre viendra bousculer. C'est dans ce contexte que le correspondant local, Alexandre Lolya, se retrouvera, plus ou moins malgré lui, à mener sa propre enquête.
Correspondant local est un polar classique, à l'intrigue efficace et maîtrisée. L'histoire est trouble, sinistre, mais est également parfaitement ancrée dans la réalité décrite par l'auteur. En effet, ce roman charme surtout par son atmosphère. L'auteur parvient parfaitement à nous plonger dans cette ambiance feutrée et enveloppante propre aux petites localités paisibles. Ce genre d'endroit où tout le monde se connaît ou presque, et dans lequel, lorsqu'un fait sortant des habitudes surgit, les vieilles histoires… les vieux secrets jaillissent subitement du placard.
Alexandre Lolya est donc le protagoniste rêvé pour dévoiler les passés troubles de ses concitoyens, de par sa forte implication dans la vie locale. Son côté très ordinaire en fait un héros particulièrement crédible, éminemment sympathique, et on prend un plaisir certain à le voir se faire entraîner dans tout ça.
Sans révolutionner le genre, Laurent Queyssi arrive donc à se démarquer de certaines tendances actuelles allant vers des polars de plus en plus violents et des héros de plus en plus invulnérables, pour revenir à l'essentiel de ce qui fait un bon roman : l'authenticité d'une région, qu'on a réellement l'impression de parcourir au fil des pages, la crédibilité d'une intrigue, qui la rend d'autant plus captivante, et la franche humanité d'un héros ordinaire, pour lequel l'empathie est immédiate.
Correspondant local | Laurent Queyssi | Filature(s)
 Ne vous fiez pas à son titre ou au fait que ce livre ait été publié par les Éditions Le Bélial' (éditeur de l'imaginaire, s'il en est) Comment parle un robot ? n'est ni un ouvrage de SF, ni un ouvrage de pop-culture. Le pedigree de l'auteur peut cependant mettre la puce à l'oreille : Frédéric Landragin est en effet docteur en informatique-linguistique et directeur de recherche au CNRS, excusez du peu...
Ne vous fiez pas à son titre ou au fait que ce livre ait été publié par les Éditions Le Bélial' (éditeur de l'imaginaire, s'il en est) Comment parle un robot ? n'est ni un ouvrage de SF, ni un ouvrage de pop-culture. Le pedigree de l'auteur peut cependant mettre la puce à l'oreille : Frédéric Landragin est en effet docteur en informatique-linguistique et directeur de recherche au CNRS, excusez du peu...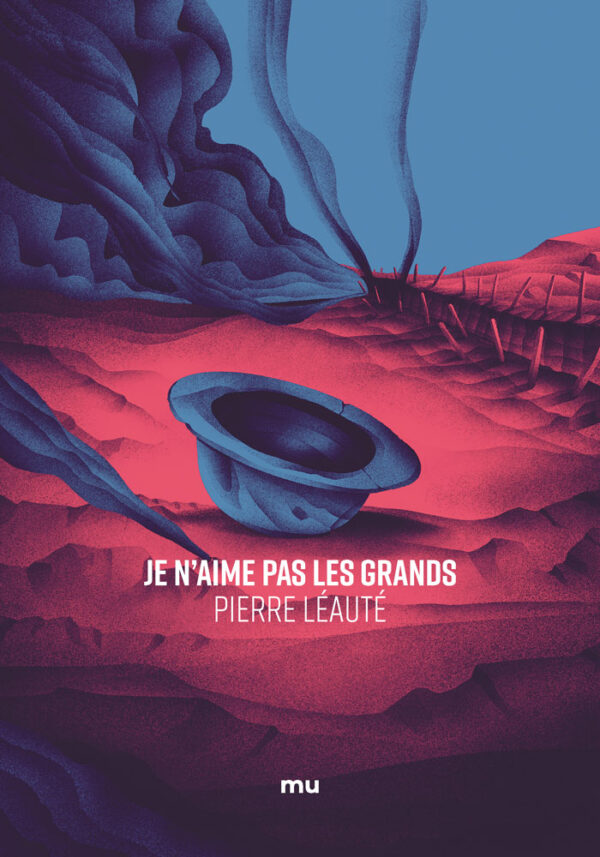
 Découvert par hasard, je ne peux que vous conseiller ce court métrage d'Aude Gogny-Goubert qui narre la rencontre entre une jeune femme fascinée et une actrice ambigüe, objet de sa fascination.
Découvert par hasard, je ne peux que vous conseiller ce court métrage d'Aude Gogny-Goubert qui narre la rencontre entre une jeune femme fascinée et une actrice ambigüe, objet de sa fascination.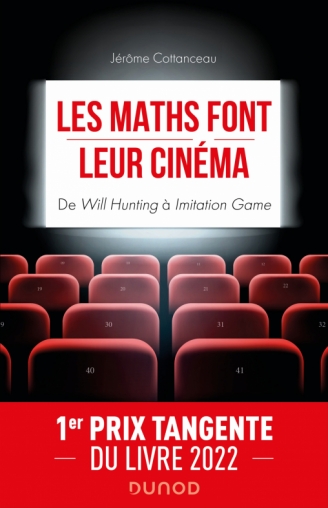 Cela faisait un moment que je n'avais pas parlé de maths ! Non ? Si !
Cela faisait un moment que je n'avais pas parlé de maths ! Non ? Si !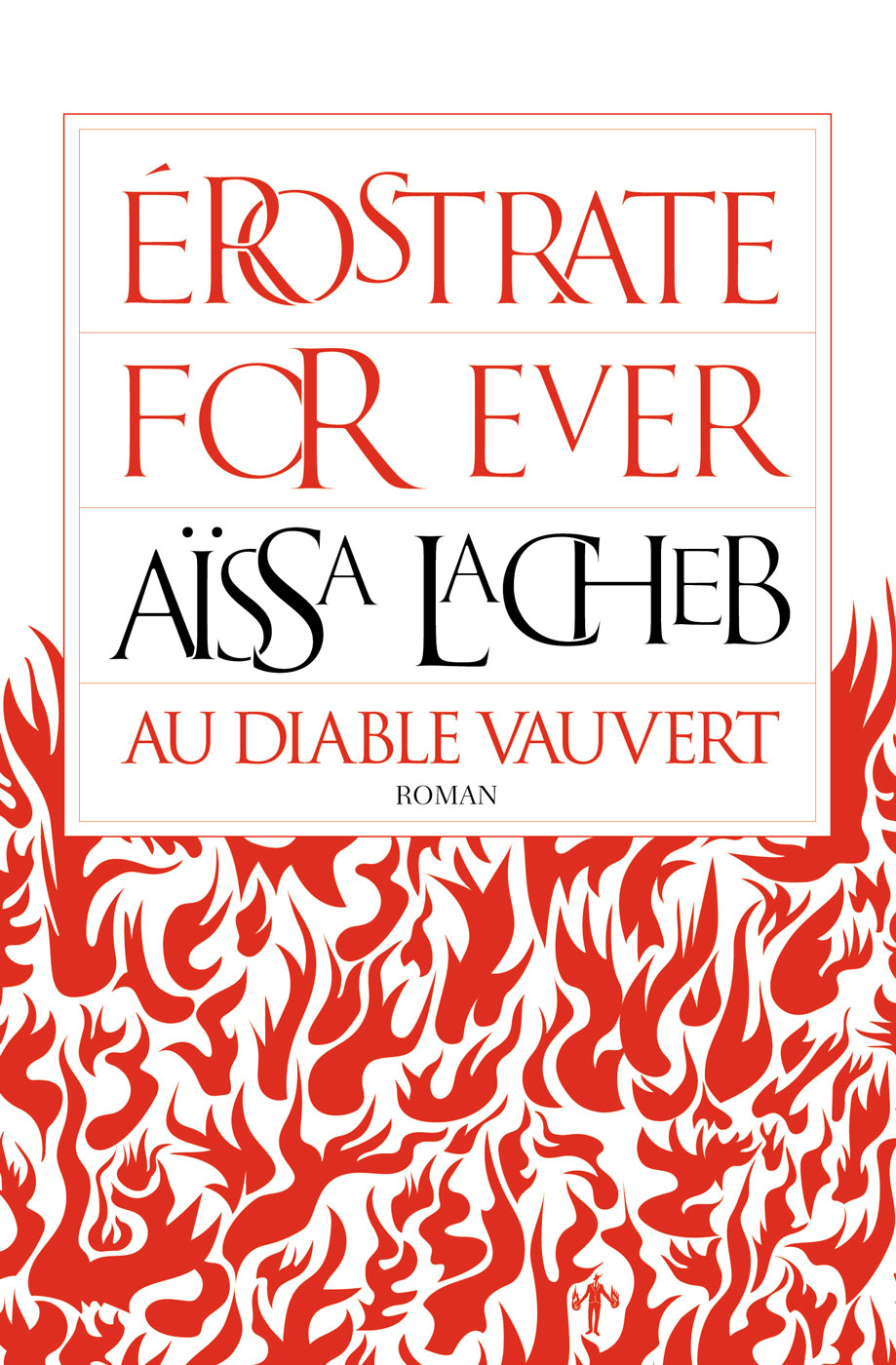
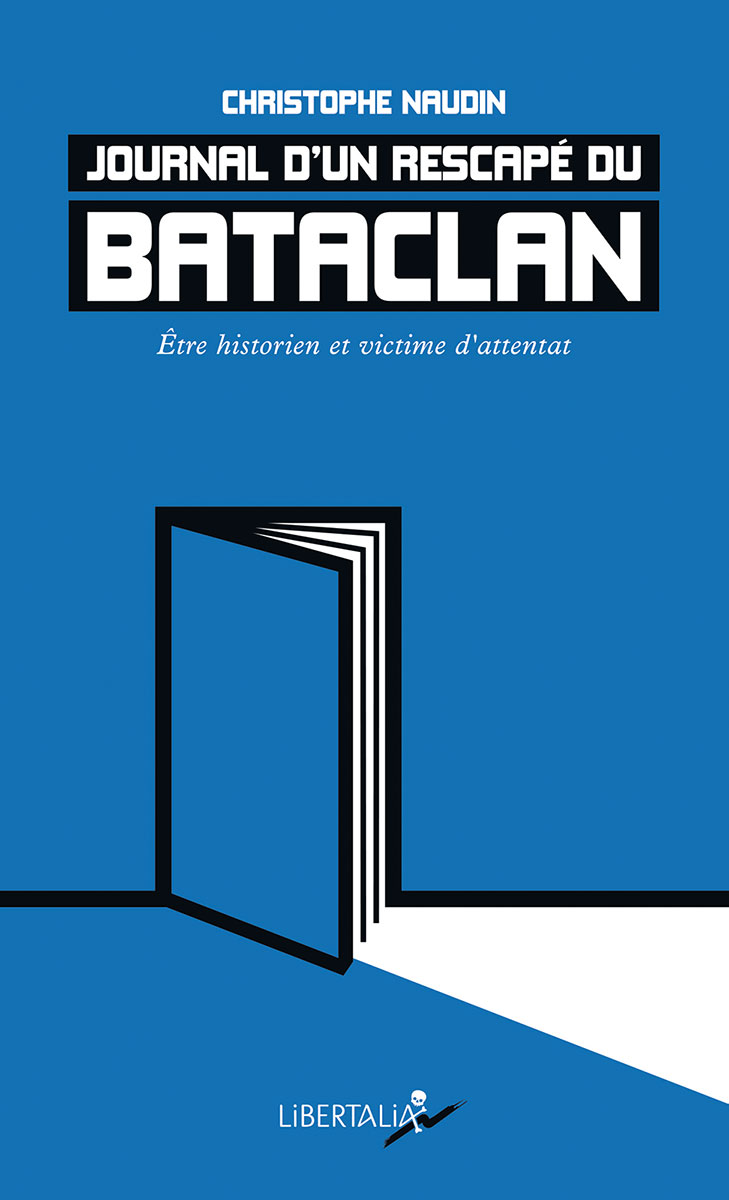 C'est, je pense, un immense cadeau que nous a fait Christophe Naudin en nous livrant le contenu du journal qu'il a tenu de décembre 2015 à décembre 2018, après avoir survécu à l'attentat du Bataclan. Dans un premier temps car il a tenu à le laisser brut, sans réécriture. Il s'agit donc d'un témoignage extrêmement dur, évidemment, écrit par un auteur souvent sous la coupe de troubles du stress post-traumatique, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la psyché.
C'est, je pense, un immense cadeau que nous a fait Christophe Naudin en nous livrant le contenu du journal qu'il a tenu de décembre 2015 à décembre 2018, après avoir survécu à l'attentat du Bataclan. Dans un premier temps car il a tenu à le laisser brut, sans réécriture. Il s'agit donc d'un témoignage extrêmement dur, évidemment, écrit par un auteur souvent sous la coupe de troubles du stress post-traumatique, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la psyché.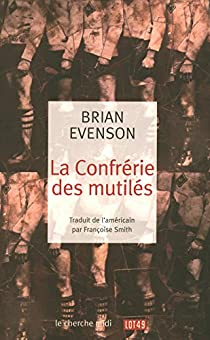 Je ne me rappelle plus comment j'ai entendu parler de La confrérie des mutilés. Toujours est-il que je pensais avoir à faire avec un roman policier un peu trashouille puisqu'il aborde le monde très (ré)créatif de la mutilation.
Je ne me rappelle plus comment j'ai entendu parler de La confrérie des mutilés. Toujours est-il que je pensais avoir à faire avec un roman policier un peu trashouille puisqu'il aborde le monde très (ré)créatif de la mutilation.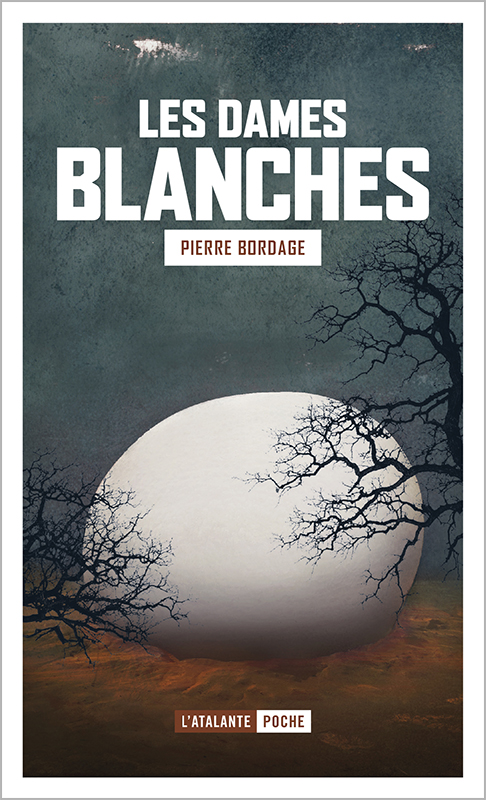 C'est la première fois que je m'attelle à Bordage, et je ne regrette pas du tout d'avoir enfin fait connaissance avec les écrits de ce grand auteur de science fiction. Il y a en effet dans ces Dames blanches des montagnes de réflexions qui vont bien au delà du mystère qu'elles suscitent.
C'est la première fois que je m'attelle à Bordage, et je ne regrette pas du tout d'avoir enfin fait connaissance avec les écrits de ce grand auteur de science fiction. Il y a en effet dans ces Dames blanches des montagnes de réflexions qui vont bien au delà du mystère qu'elles suscitent. Funèbre ! est un court livre passant en revue différents rites autour de la mort ou plutôt, différentes traditions liées à la perte d'un proche partout autour du monde.
Funèbre ! est un court livre passant en revue différents rites autour de la mort ou plutôt, différentes traditions liées à la perte d'un proche partout autour du monde.