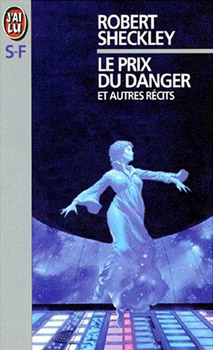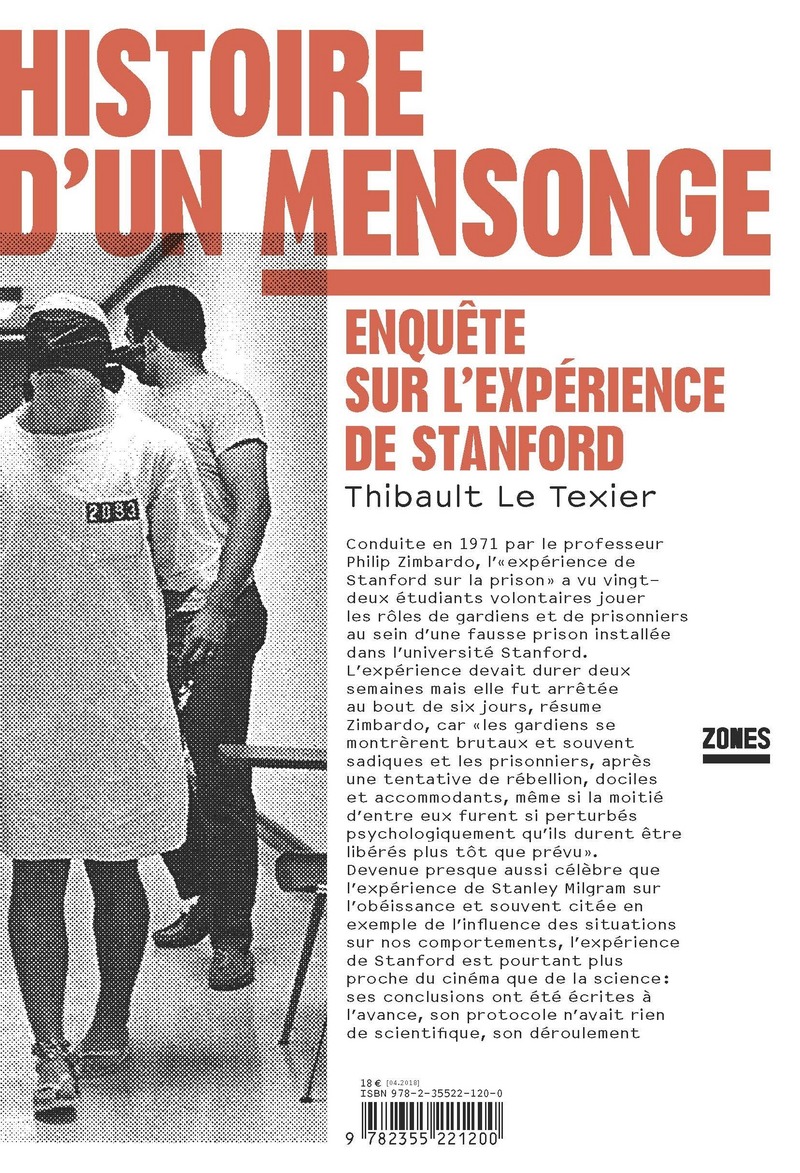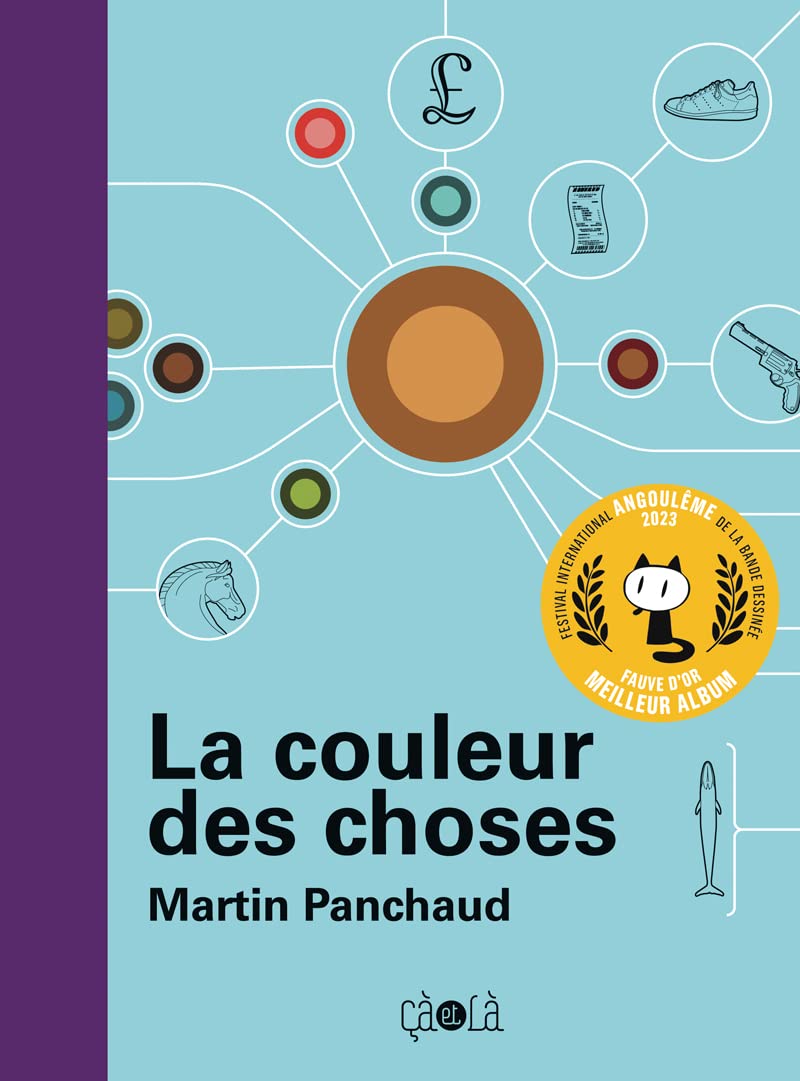Briser les os

J’ai découvert Briser les os presque par hasard, piquée par son intrigante quatrième de couverture. Faisant par habitude confiance aux éditions Argyll, j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir l'univers de Cassandra Khaw, autrice malaisienne peu traduite en français. En quelques lignes, le décor de fantasy urbaine obscure était posé, terrain d'une enquête aux relents paranormaux. Si l'univers était prometteur, la lecture m’a tout de même laissé un sentiment contrasté.
Le roman nous invite à suivre John Persons, archétype du détective tourmenté, marqué par une part d’ombre et possédant en plus des capacités surnaturelles. Approché par un jeune garçon souhaitant l'engager pour tuer son beau-père abusif, il va rapidement se rendre compte que ce dernier cache bien des manières d'être un monstre.
Si le personnage principal coche un peu toutes les cases du genre (solitaire, rude, hanté par son passé), l'auteur a su lui insuffluer suffisamment d'épaisseur pour le rendre intéressant à suivre. Le véritable souci de lecture tient moins de ce qui nous est présenté de lui que de ce qui ne nous est pas dit. En effet, le texte parle sans cesse de sa vraie nature, de ses pouvoirs, de certains événements passés, comme si le lecteur était déjà au courant, sans que cela soit le cas. Cette opacité finit par déstabiliser.
Malgré cette réserve, là où Briser les os se distingue vraiment, c’est par l'angle choisi pour aborder des thèmes extrêmement lourds. La monstruosité, motif central du récit, n’est pas seulement littérale : elle se confond, dans une métaphore puissante, avec les violences familiales. Le texte choisit la suggestion, le détour symbolique, plutôt qu’un discours frontal.
L’écriture, dynamique et évocatrice, se prête efficacement à la représentation de cette ambiance sombre et urbaine. Les scènes s’enchaînent avec fluidité, et le style parvient à être à la fois nerveux et sensible. En revanche, l’univers dans lequel il nous plonge n’est jamais véritablement expliqué, les règles ne sont pas posées et de nombreuses allusions restent obscures. Résultat : une sensation de flottement et l’impression de ne pas avoir saisi toutes les clés de l’histoire.
Je serais donc bien en peine de recommander vraiment Briser les os à moins d'être prêt à accepter une part de confusion et de ne pas être trop sensible aux récits qui abordent la question des violences familiales. Il y a tout de même dedans des trouvailles qui valent le coup d'être découvertes pour peu qu'on lâche un peu prise… quitte à rester, parfois, un peu à distance du récit.
Briser les os | Cassandra Khaw | traduit par Marie Koullen | Argyll