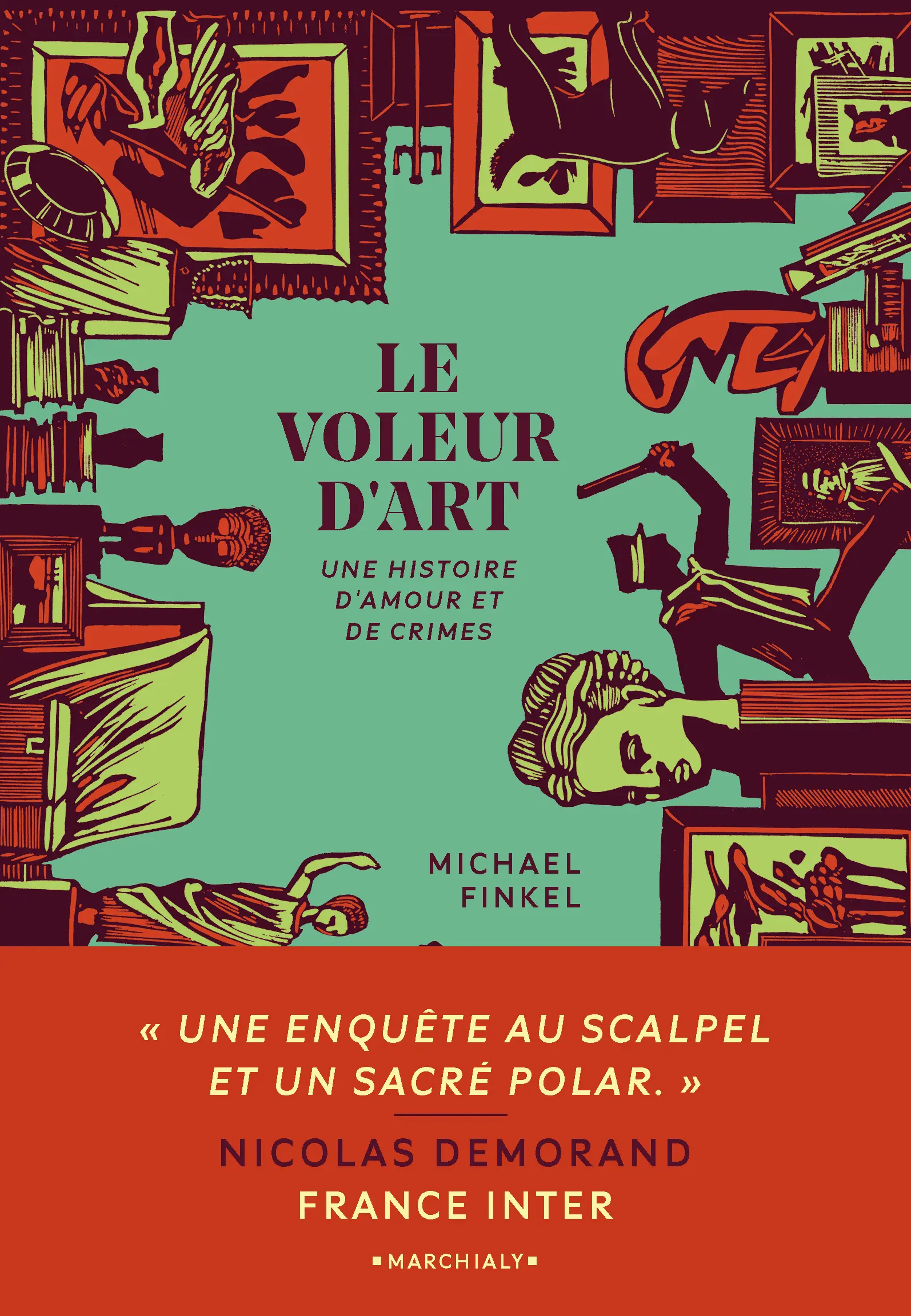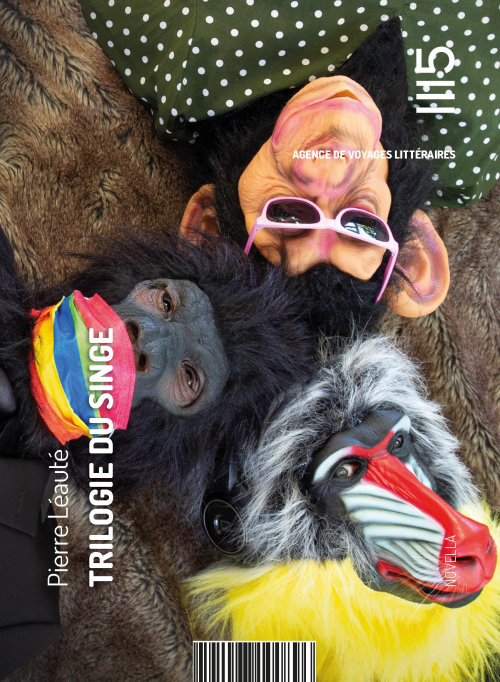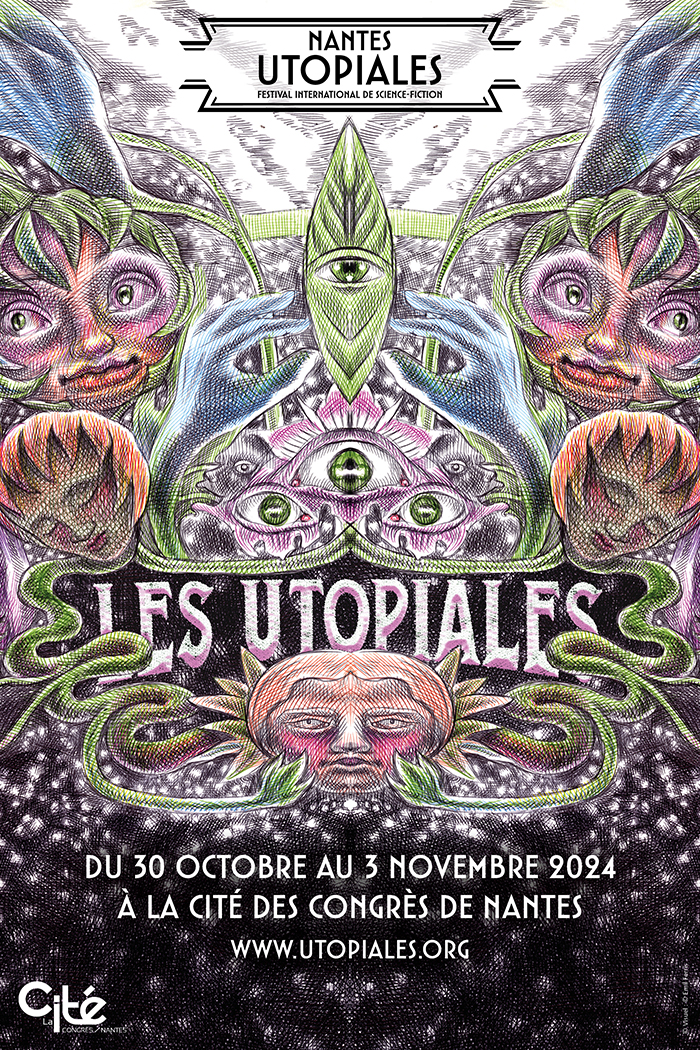L'équation de la chauve-souris
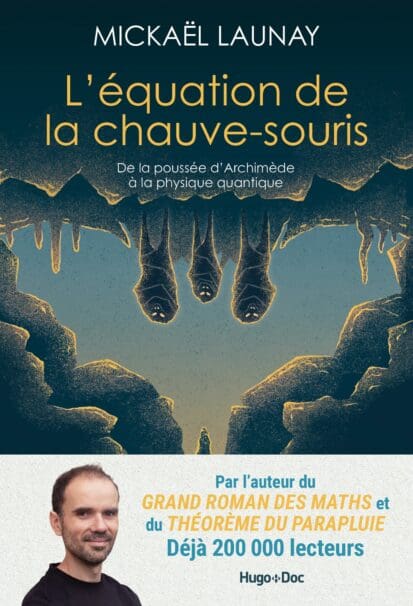
Ce n'est pas le premier livre de Mickaël Launay que je lis (je les ai tous lus), mais c'est le premier dont je parle sur Un Spicilège. Pour ceux qui ne connaissent pas mon admiration pour le travail de cet auteur, je vous préviens : je considère Mickaël Launay comme l'un des meilleurs vulgarisateurs que je connaisse. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à sa chaîne Youtube, et à mon avis sur un autre de ses ouvrages (Le théorème du parapluie) sur mon ancien blog.
On retrouve la même structure dans L'équation de la chauve-souris que dans Le théorème du parapluie : 5 parties, chacune abordant un grand thème scientifique, qui commencent toujours par une anecdote de la vie courante qui fait se poser des questions théoriques à l'auteur. Par exemple que peut nous apprendre la cuisson des coquillettes sur la théorie du chaos ? (Si, si, il y a bien un rapport !)
Ce qui est flagrant à la lecture des livres de cet auteur, c'est à quel point il a à cœur non pas de présenter les principes physiques qui expliquent les observations que l'on peut tous faire au quotidien, mais de les concrétiser. Je vous assure que la première partie consacrée à la pression et autre poussée d'Archimède est la plus brillante que j'ai jamais lu sur le sujet. Jamais vous ne vous sentirez plus perspicace qu'après la lecture de ce livre et jamais une courbe de Gauss ou une équation des ondes ne vous auront si peu effrayé (en cela, les brillantes illustrations de Chloé Bouchaour aident également). Mickaël Launay possède cette faculté propre aux bons vulgarisateurs qui est d'inscrire dans le réel, dans le palpable, une notion théorique. En repartant souvent de l'origine d'une découverte, il parcourt certaines scènes de l'histoire des sciences (discipline qui est malheureusement trop peu enseignée), nous permettant de nous mettre à la place de ceux qui, en leur temps, ont résolu l'énigme, et tout à coup, tout devient limpide.
Un livre à conseiller à tous, dès l'adolescence, surtout les personnes fâchées avec les équations.
L'équation de la chauve-souris | Mickaël Launay | Illustrations de Chloé Bouchaour | Hugo Doc