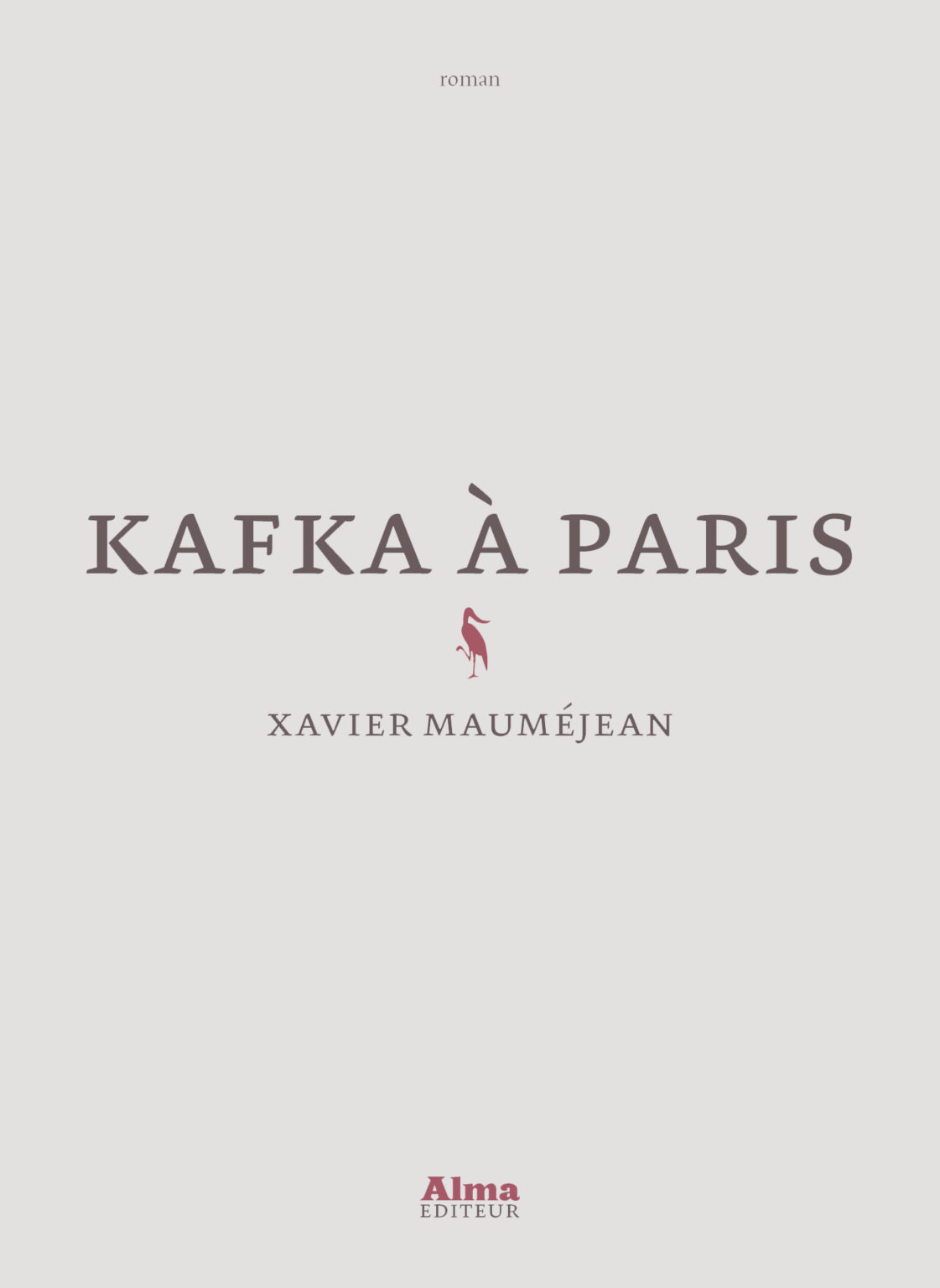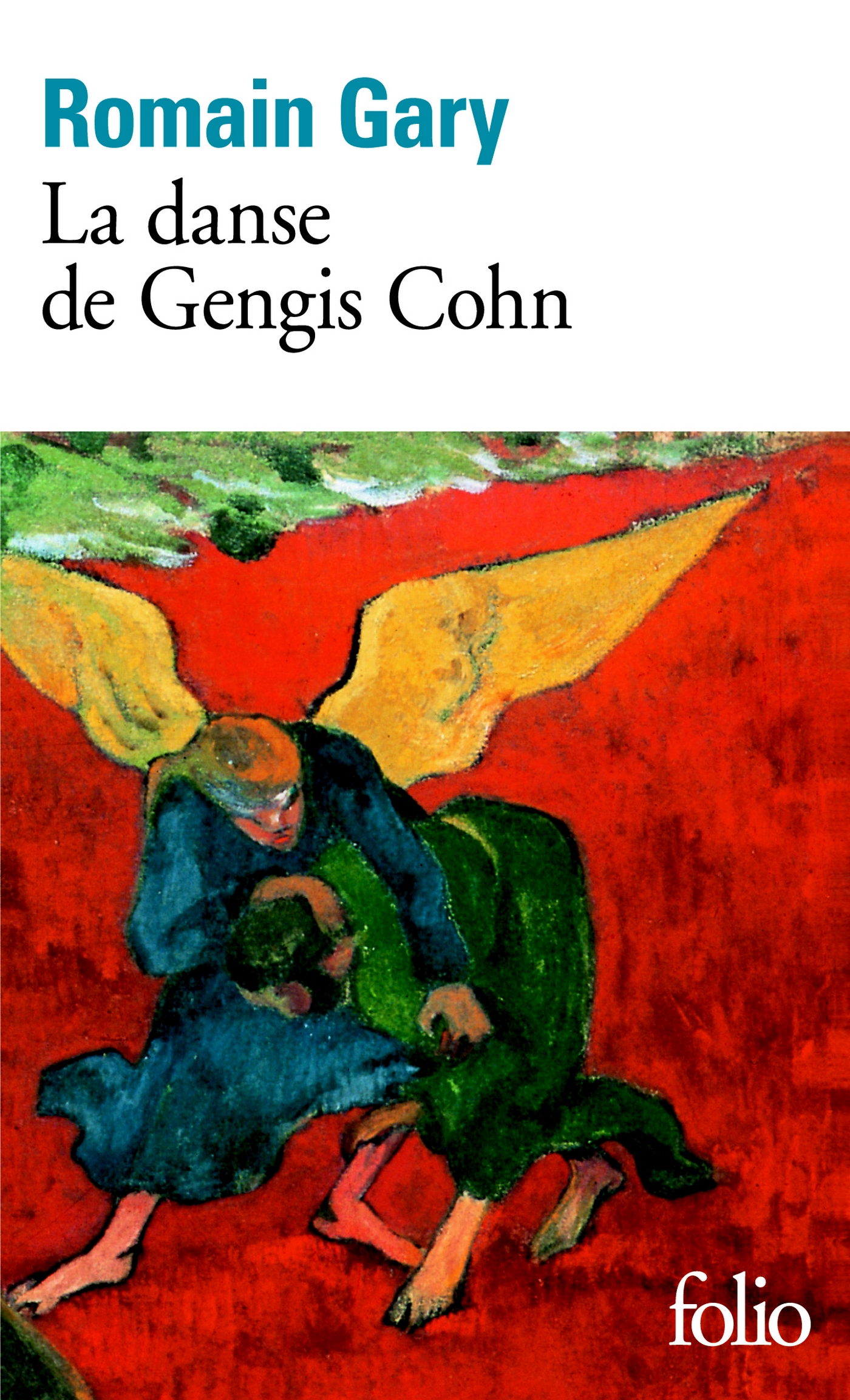Tant que le café est encore chaud
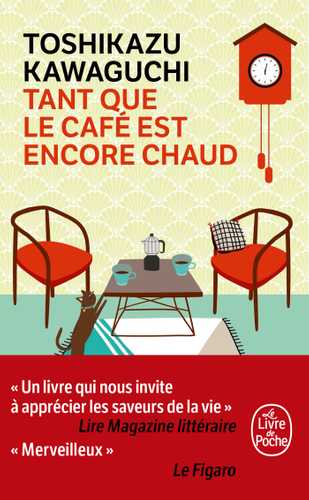
Prêté par une amie qui me l'a chaudement recommandé, c'est avec une envie de douceur et de quiétude que j'ai lu Tant que le café est encore chaud. J'avais déjà entendu parler de ce court roman mais je n'en soupçonnais pas l'ampleur du succès que je ne trouve pas volé.
En effet, Tant que le café est encore chaud m'a semblé une petite bulle de poésie et de plaisir doux-amer, une fable dont l'ambiance semble bien être celle que j'imagine quand je songe au Japon. Il conte l'histoire d'un café un peu secret de Tokyo qui permet à qui connaît bien les règles de retourner un court instant dans le passé. Sachant dès le début que quoi qu'il s'y passe, cela ne changera pas leur présent, 4 femmes vont pourtant faire le voyage.
A travers ces 4 destins, le roman nous amène très doucement à notre propre introspection, notre rapport au temps, nos remords ou nos regrets passés. Pourtant, il est empreint d'une douce positivité, d'une philosophie toute nippone misant sur l'éveil personnel, la compréhension et la paix intérieure.
Écrit dans un style épuré qui fait la part belle aux émotions, il touche immédiatement par son ton gracieux et par sa pudeur délicate. Un court moment de lecture réconfortant, les effluves de café en prime.
Tant que le café est encore chaud | Toshikazu Kawaguchi | traduit par Miyako Slocombe | Le livre de poche
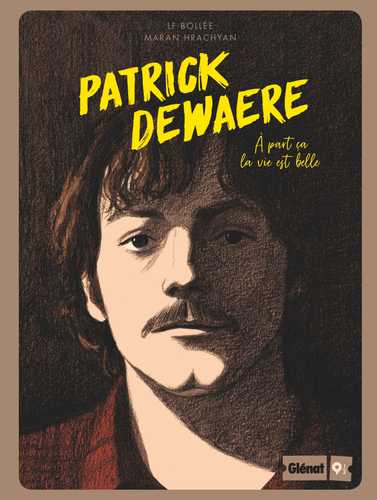





 C'est un petit bijou d'écriture comme seul Le Dilettante a réussi à m'en faire découvrir que ce premier roman de Pauline Toulet.
On y lit les histoires inattendues d'Anatole Bernolu, un personnage atypique, discret, étrange et surtout, un personnage assez seul, persuadé d'avoir fait une grande découverte au sujet de Claude Lévi-Strauss et déterminé à le faire savoir.
Mais au-delà d'un récit en trompe-l'œil, c'est avant tout l'écriture inventive et maîtrisée de Pauline Toulet qui m'a réjouie pendant cette lecture.
C'est un petit bijou d'écriture comme seul Le Dilettante a réussi à m'en faire découvrir que ce premier roman de Pauline Toulet.
On y lit les histoires inattendues d'Anatole Bernolu, un personnage atypique, discret, étrange et surtout, un personnage assez seul, persuadé d'avoir fait une grande découverte au sujet de Claude Lévi-Strauss et déterminé à le faire savoir.
Mais au-delà d'un récit en trompe-l'œil, c'est avant tout l'écriture inventive et maîtrisée de Pauline Toulet qui m'a réjouie pendant cette lecture.