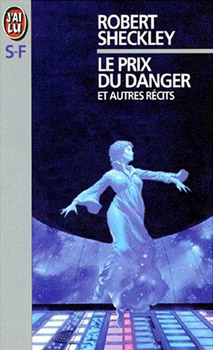#Société #Féminisme
J'écris cet article pour réfléchir sur les violences au sein des groupes, qu'ils soient militants, professionnels, ou amicaux. Je voudrais parler de la difficulté à dire ce qui ne va pas quand on est la victime. Et je voudrais réfléchir aux réactions qui font des autres membres du groupe des complices des agresseurs ou bien des allié·es des victimes, parce qu'il n'y a pas de position neutre.
Violences dans le groupe
Dans un groupe, il y a très souvent des violences, de la micro-agression sexiste ou raciste à l'agression caractérisée. Parfois j'ai été victime (c'est dans cette situation qu'on s'en rend le plus compte), parfois j'ai été témoin, et parfois j'ai été l'agresseuse, souvent sans le savoir.
Il me semble que plus un groupe est dysfonctionnel, plus ces violences sont systémiques et fortes. Plus le groupe est fonctionnel et plus il y a des moyens d'écouter et de réparer.
Je suis souvent frappée par le fait que les gens sont très attachés à une gradation des violences. Il y a celles qui ne sont pas très graves et qu'on devrait laisser passer s'en s'offenser, et celles qui sont vraiment graves et pour lesquelles il faut absolument agir.
Moi, je suis probablement sensible, mais elles me semblent toutes aussi injustes ! Du coup, dans ce billet, je traite exactement de la même manière :
- la micro-agression comme se faire mansplainer ou invisibiliser,
- l'agression passive-agressive du type : « Faut se détendre là »,
- et l'agression avérée comme se faire insulter : « t'es vraiment trop conne ».
Je mets tout au même niveau pour plusieurs raisons :
- Bien qu'il y ait évidemment une gradation évidente, je suis convaincue que dans les mécaniques de violence, c'est le fait qu'une personne ou le groupe accepte une micro-agression qui rend ensuite possible des agressions plus fortes.
- Les dégâts sur la victime ne sont pas proportionnels à la violence d'une agression. On peut souffrir davantage d'une micro-agression de la part de quelqu'un qu'on estime ou dont on recherche l'approbation que d'une insulte de la part de quelqu'un qu'on n'estime pas du tout.
Les réactions des allié·es
La difficulté de dire ce qui ne va pas quand on est victime de violences
La première chose, c'est que quand on est victime c'est super dur de s'exprimer. On peut avoir honte d'avoir été maltraitée et de ne pas avoir su répondre. Et on peut avoir peur de la réaction des autres si on exprime ce que l'on a vécu et comment on l'a ressenti.
Les (mauvaises) réactions habituelles
Les réactions des autres quand on exprime quelque chose qui nous fait du mal sont souvent mauvaises au sens où elles n'améliorent pas la situation, ni pour la victime, ni pour le groupe. Voici quelques exemples des réactions que j'ai fréquemment rencontré :
- On va me dire que ce n'est pas grave, que je suis une personne trop sensible, que ce qui compte c'est que le projet avance, etc. ...
Dans ces cas là, la personne qui écoute n'écoute pas. Elle nie ce que je ressens ; et c'est rajouter de la violence sur la violence.
J'en avais parlé dans cet article.
- On va m'expliquer comment j'aurais du faire différemment pour que l'autre se comporte mieux (« tu aurais pu utiliser d'autres mots, c'est vrai que 'je suis surprise' peut être vu comme passif-agressif »). Et en fait, dans ce cas là, on inverse la responsabilité : on met sur moi, la victime, la responsabilité de l'agression.
- On va trouver que je suis chiante, pas cool, trop sensible, et on va faire en sorte de se passer de moi sur des nouveaux projets / pour de nouvelles activités. On va m'écarter progressivement.
- On va me dire qu'on ne peut pas prendre position car « je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants », comme si il fallait d'abord comprendre l'agresseur, surtout quand c'est un homme (bonjour l'himpathie) ou quelqu'un de l'élite (toujours au sens de Jo Freeman).
Cette liste n'est surement pas exhaustive. N'hésitez pas à me contacter (via mastodon) pour la compléter avec vos expériences.
Ainsi, les réticences à parler de la part des victimes ne sont pas des pensées limitantes ou des fausses peurs. Ce sont des craintes réalistes car c'est ce qui se passe la majorité du temps tant que les violences ne sont pas suffisamment violentes, et qu'il n'y a pas suffisamment de preuves aux yeux de la personne qui écoute.
Et ça rend d'autant plus désagréables les remarques du type : « Bah pourquoi t'en as pas parlé plus tôt ? ». Plus on en parle tôt, plus le risque de ne pas être entendue est fort puisque les violences n'auront pas encore été assez graves.
Les meilleures réactions (plus rares)
Parfois, une victime parle, et elle est entendue ! 🎉
Écouter, et ne rien faire
C'est déjà génial, mais souvent ça n'est pas du tout suffisant car ensuite, si les allié·es potentiel·les ne font rien, la situation au sens systémique ne change pas, voir empire. Les personnes qui sont violentes, peut être sans s'en rendre compte, sont renforcées dans ce comportement (pas de conséquences négatives, voir même des conséquences positives avec les autres qui rient à leur blague, qui soutiennent leurs projets, etc). À court ou moyen terme, la victime va s'effacer, ou partir.
Souvent, les allié·es qui écoutent et comprennent ne vont pas plus loin. Iels vont dire : « c'est pas cool en effet », ou, « tu as raison, ils n'ont pas respecté le réglement qu'on avait décidé collectivement », et ça s'arrête là. En général, l'allié·e explique qu'iel comprend les deux points de vue, (comme s'il y avait violence des 2 côtés), et que ce n'est pas assez grave pour passer à l'action.
Moi, j'ai l'impression que l'allié·e s'est juste acheté une bonne conscience, mais c'est vrai que c'est mieux que de ne pas être écoutée du tout.
Écouter, et agir
Et parfois, la personne qui écoute va faire quelque chose 💪 🎉.
Là je crois qu'il faut encore distinguer deux situations car l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Parfois l'allié·e agit sans demander à la victime si c'est une bonne idée. Et ça, ça n'est pas une bonne idée (et je l'ai parfois fait, et je le regrette comme je le raconte dans cet article : cet article ici)
Ce n'est pas une bonne idée car nos bonnes idées de sauveur·se peuvent empirer la situation du point de vue de la victime.
La bonne réaction il me semble, c'est que l'allié·e demande ce qu'elle peut faire, ou propose des actions et demande à la victime son avis.
Il est vrai que récemment on m'a demandé ce qu'on pouvait faire pour m'aider, et j'ai été gênée. Je ne voulais pas embêter la personne qui propose de m'aider vu que déjà elle m'a écoutée. Note à moi-même, oser répondre sincèrement à cette question. Mais en réalité, c'était une très bonne attitude de la part de mon amie, et je la remercie encore 💙.
Agir en tant qu'allié·e avant que les choses ne soient graves
Mais on ne va pas se mentir, plus le temps passe, plus la situation est installée, plus il est difficile pour la personne qui écoute d'avoir le courage d'agir comme un·e allié·e.
J'ai entendu plusieurs fois des allié·es dire : « c'est vraiment nul, je suis avec toi, je lui en parlerai quand ça sera le bon moment ».
Et spoiler : ça n'a jamais été le bon moment. Maintenant quand j'entends ça, je me dis que la personne s'achète une bonne conscience. Et je comprends pourquoi, c'est difficile et ça demande du courage car l'allié·e a souvent à perdre à intervenir auprès de l'élite du groupe.
Agir lors des micro-agressions
J'ai longtemps réfléchi au cas d'une amie dont le mari est violent verbalement. Il ne l'a jamais touchée (ou en tous cas pas devant moi), mais il se moque facilement d'elle en ma présence, il la critique en permanence, et je n'ai jamais rien dit car je n'osais pas, par peur d'envenimer les choses, et peut-être aussi par couardise. Avec le temps, ça me semble de plus en plus difficile d'intervenir vu que je ne suis pas intervenue pour les mêmes faits par le passé. En fait, j'ai normalisé certains de ses comportements toxiques en ma présence.
J'avais parlé plusieurs fois à mon amie de ces situations que je ne trouvais pas OK, et elle me disait que c'était pas grave. Et puis un jour, elle m'a dit que c'était un problème que personne ne réagisse face à des violences conjugales. Alors je me suis promis d'être une alliée la prochaine fois, mais je n'avais aucune idée de comment faire.
J'étais tétanisée à l'idée de réagir lors d'une grosse dispute, ça me paraissait impossible. J'ai fini par réaliser que c'était beaucoup plus facile, et moins dangereux, de réagir à une mini-violence qu'à une grosse colère. Je peux refuser de rire à des blagues offensantes (« c'est pas hyper drôle comme blague si? »), ou juste de dire « ça me met mal à l'aise » quand une interaction me met mal à l'aise.
Je généralise cette situation à la vie dans un groupe. L'un des gros défauts des groupes est d'attendre pour agir :
- Soit que les choses soient très graves,
- Soit que quelqu'un·e se soit plaint.
Je pense au contraire que l'inclusion, la lutte contre toutes les formes de violence est de la responsabilité de tous les membres du groupe. Et être un·e allié·e, ou un membre responsable, c'est réagir dès que l'on perçoit une micro-agression.
- Soit à chaud, en disant qu'on est gêné, ou que la blague n'est pas drôle, ou en demandant pourquoi cette phrase ?
- Soit à froid,
- En allant voir la victime, pour lui apporter du soutien,
- En allant voir l'agresseur·se, pour lui expliquer en quoi son comportement (et pas sa personne) n'est pas OK
- En provoquant un moment de réflexion au sein du groupe sur le type de violence qu'on a repéré, même si c'est à un stade très léger.
Conclusions
Ce que je retiens de cette histoire c'est qu'être un·e bon·ne allié·e, c'est :
- Prendre sa responsabilité dans le climat du groupe, et réagir lors des micro-agressions. Ne pas laisser passer des choses parce que : « C'est pas très grave tant qu'il n'y a pas d'insultes ou de coups ».
- Demander aux personnes qui sont victimes de micro-agressions comment elles le vivent. Si ça se trouve très bien, si ça se trouve elles ont besoin d'aide.
- Écouter vraiment, sans minimiser, quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui lae gène dans le groupe.
- Proposer d'agir (et pas juste “d'aider”) pour la personne, et pour le groupe, et écouter pour de vrai la réponse.
Il n'y a pas de neutralité dans une société inégalitaire
Il n'y a pas d'observateur·trice neutre. Ne pas prendre position contre l'agresseur c'est de facto se placer à ses côtés, et le soutenir.
Quand vous dites à une personne que vous la comprenez et la soutenez, et que vous vous arrêtez là, dans les faits, vous soutenez les agresseurs.
Voilà, j'ai mis longtemps à écrire cet article, je l'ai d'abord fait pour m'aider moi et ranger mes idées. Je pense que j'aurais aimé avoir « ça » dans la formation sur les VSS qu'on a eu au parti Les Écologistes. Je suis curieuse d'avoir vos retours et vos ressentis...