from AAR
Voici un premier billet de blog.
Les derniers billets publiés sur BlogZ
from AAR
Voici un premier billet de blog.
from le chat sauvage
Luddisme et possibilités
Je reproduis ici un texte que j'ai écrit le 2 novembre 2025.
Hier, j’ai fini le livre “Un taylorisme augmenté : critique de l’intelligence artificielle” de Juan Sebastian Carbonell, et je le recommande vivement. Ce qui m’a attiré l’attention, ce n’était pas seulement l’idée la plus centrale du livre — le taylorisme comme une manière historique d’organisation du travail jusqu’à présent, et la façon dont l’IA s’insère dans cette dynamique en approfondissant encore plus la division du travail et ses conséquences —, mais principalement la question du luddisme.
J’avoue que j’avais un certain “préjugé” contre les luddistes, car pour moi ils n’attaquaient pas la racine du problème derrière l’introduction de machines. Mais la conclusion du livre m’a fait changer un peu l’idée. En fait, en résistant aux machines, les luddistes ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités d’organisation du travail et d’organisation de la société. Il n’y a pas seulement un sens de destruction, mais aussi de construction de nouvelles possibilités (ou “alternatives” — le terme employé par l’auteur). Et la catégorie de “possibilité” m’est très chère :’), en opposition à la linéarité et au progrès.
L’histoire n’est pas linéaire. Et ici la critique de l’idéologie du progrès est très importante. Le progrès sert aux intérêts du capitalisme ; c’est par essence une idéologie conservatrice (dans le sens de la conservation du capitalisme). Cependant, en réalité, il existe différentes tendances, alternatives, enfin, possibilités que nous, comme humanité, pouvons bâtir. Attirer l’attention sur cela est essentiel pour nous retirer de notre confortable conformisme. L’avancement des technologies qui servent à des intérêts capitalistes n’est pas inévitable.
Il faut néanmoins arrêter de concevoir la critique de l’IA de façon individualiste et moraliste. Au lieu de cela, il faut penser et se mobiliser collectivement. Il ne s’agit donc pas de juger moralement celui qui utilise l’IA. La personne qui refuse son utilisation n’est pas moralement supérieure à celle qui l’utilise. La réponse doit toujours être collective, en cherchant les racines sociales de cette problématique.
Ce livre attire l’attention sur plein de choses importantes concernant l’IA et les justifications sociales que l’on donne pour son utilisation. J’aimerais bien avoir le temps de développer cela, mais je m’arrête ici pour aujourd’hui.
from F & M
On dit que la vie est un long fleuve tranquille. Pour moi, elle est un ruisseau.
Ce ruisseau du sud-ouest, tantôt aride, tantôt rendu impétueux par la pluie diluvienne.
Un bouchon de liège est piégé là, dans son lit.
Une main invisible l’a lancé là,
après avoir été expulsé d’une bouteille.
C’était une nuit, à quatre heures du matin.
Depuis ce temps-là, dans la chaleur torride d'août, il aspire à un peu d’eau tombée du ciel pour que ça bouge.
Parfois une averse arrive.
La voilà enfin. Mais le temps capricieux s’acharne.
Les trombes d’eau s’abattent sur lui, le transportent brutalement dans toutes les directions, le privent d’air – comme si cette main qui l’avait expulsé s’amusait à le tourmenter.
Projeté sur les aspérités rugueuses, il perd peu à peu sa substance.
Jadis, il côtoyait le vin, la joie, le bonheur. Il essaie de s’en souvenir, croyant faire revenir les temps où tout pétillait autour de lui.
Mais c’en est trop.
Trop puissant, ce flot, cette fois.
L’eau et le vin ne se mélangent pas.
Il aperçoit, non loin, le récif – son salut qu’il ne pourra atteindre.
Soudain, un violent remous, les chocs, le tourbillon ont raison de lui.
Perdu pour toujours. Qui s’en soucie ?
Quelqu’un passe là et ne voit rien d’intéressant. Rien qui accroche le regard.
...
L’été a chassé de nouveau les nuages. Un petit garçon joue près du ruisseau asséché et trouve un bouchon qui attire son attention.
Il le saisit et, curieux, le tourne dans tous les sens.
Il reconnaît, encore un peu visibles, des lettres qu’il a apprises à l’école.
Elles sont râpées, mais il lit à haute voix :
N… puis o… puis k…
Il a fièrement déchiffré le mot :
Nok !
from 𝐋🅦🆄𝐢𝖇-ᖆ_🐧
Pitain, j'en peux plus des correspondants qui font n'importe quoi avec mon adresse #Email
Tu leur donnes une fois, pour un échange spécifique, ils se la refilent dans d'autres services internes avec lesquels tu n'a rien à voir, et auxquels tu n'as pas donné de #Consentement.
Un coup ils t'écrivent sur cette adresse, un coup ils t'écrivent sur une ancienne adresse que tu leur a demandé de mettre à jour 3 fois déjà.
Ils te font des #MailingList où tout le monde voit les adresses des autres.
Tu la donnes à un secrétariat médical pour un #RDV et tu retrouve avec des notifications #Doctolib (et par sms) sans pouvoir exercer simplement et correctement ton droit à la rectification.
Ils gardent tes #DonnéesPersonnelles pendant plus d'une décennie dans leur base de donnée, au mieux ils la revendent au pire ils se font pirater.
Tu t'en sert pour correspondre avec plusieurs destinataires électroniquement, ils s'en servent comme d'un espace de #Chat, en faisant répondre à tous, et en incluant toutes les réponses précédentes de tout le monde. Et maintenant ils font même des likes sur des emails. #WTF
Tu passe une commande professionnelle (B2B), ils t'inscrivent à leur pitain de #Newsletter, “gérée” par un site tiers, qui n'en n'a rien à faire de tes demandes de désinscriptions via leurs propres formulaires.
Même gérer de emails poubelle/éphémère et autres alias c'est devenu l'enfer avec tous ça, et je ne parle même pas de #Spam.
from Un joyeux boxon
Salut ! :)
Vous connaissez Volu ? Je lui ai honteusement piqué le concept qu'elle intitule La Pile, hérité de la fameuse “pile à lire”.
Nouvelle année, nouvelle résolution que je vais essayer de tenir, j'inaugure ainsi ma première note de blog, chose que je n'avais pas fait depuis au moins 20 ans. #TeamVieux Et pour bien faire les choses, on commence par janvier 2026.
Un mois à la fois plutôt tranquille en terme de nombre de jeux, et très rempli étant donné le nombre d'heures particulièrement déraisonnable que j'y ai passé. Bien que j'ai fait un bref détour par Virtua Figther 5 REVO pour me faire savater par Shenron et sa team lors du stream mensuel sur leur chaîne Twitch, j'ai surtout passé près de 100 heures (ouch) sur le terrible Arc Raiders.
Dire que j'ai été happé est un euphémisme. La direction artistique tout d'abord, qui sert une ambiance curieusement contemplative pour un jeu où l'on est amené à tirer sur à peu près tout ce qui bouge. Que ce soit l'architecture, les lumières, les vastes étendues post-apocalyptiques où se côtoient quelques robots esseulés et une faune inattendue, tout me parle sans que je puisse vraiment encore comprendre pourquoi (mais j'y bosse, peut-être en vue d'une future vidéo ?). Il faut dire que jouant non pas contre mais avec d'autres personnes, je prends mon temps en me baladant, en observant, en me posant parfois in game avec ma guitare, seul, sur le toit d'un immeuble en ruine au soleil couchant. Oui, c'est inattendu mais ce jeu m'apaise.
Je ne me suis jamais défini comme cinéphile, considérant que ce statut nécessite un certain degré de connaissance en la matière, chose que je n'ai pas. En revanche, je m’attribue volontiers celui de cinéphage. Curieux de tout, amoureux des OVNI filmiques de tous bords, j'aime avant tout être surpris. De fait, si certaines déceptions sont au rendez-vous, les belles surprises le sont également. En ce moment, j'essaie en particulier de sortir de ma zone de confort en regardant des films autres que des classiques d'avant les années 70 (#TeamVieux, vous vous souvenez ?).
Ainsi, quelques films que je retiendrai en ce mois de janvier 2026 :
Justement, un bel OVNI que voici. Premier long-métrage de Michel Hazanavicius, on y suit les mésaventures de deux minables, l'un producteur d'une sitcom de troisième zone, l'autre acteur dans cette même sitcom, qui se réveillant tous deux aux côtés d'une femme morte vont tenter d'en cacher le corps. Tout ressemblance avec les productions AB n'est absolument pas fortuite. Prétexte à montrer du doigt un milieu où la médiocrité le dispute à la petitesse, cette comédie noire invite à découvrir les coulisses crasseux d'une industrie où règne les cancrelats. C'est savoureux, avec de jolies surprises scénaristiques et une fin à la morale implacable.
Oui, j'ai triché. Je parlerai un jour plus longuement de ce film, chef-d’œuvre par mis les chefs-d’œuvre. Un film grandiose à bien des égards, vu cent fois et toujours aussi majestueux. Juste, je ne me sens pas d'en parler maintenant tant il y a en dire. Mais si ce n'est déjà fait, voyez-le, idéalement avec l'intro de Cecil B. DeMille pour en saisir le propos et le contexte.
Une série que j'ai d'abord découvert en 2020 grâce à Alice in Animation (allez voir sa chaîne, c'est une mine d'or). Un humain de la préhistoire et un dinosaure unis par un drame commun, qui traversent ensemble les épreuves de la vie. C'est violent, beau, cruel, touchant et plein de choses encore. Le plaisir d'un récit sans dialogues parlés est aussi très appréciable dans une industrie où le silence n'a plus de place.
Certaines personnes considèrent ce film comme taisant certains problèmes fondamentaux rencontrés par les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai. Mais est-ce vraiment la mission de ce film ? Comment résumer le spectre du validisme, d'une société profondément injuste et inégale en seulement 1H30 ? Aucune idée. Reste qu'au-delà de son histoire simple voire simpliste, sa réalisation digne d'un téléfilm France Télévision et sa morale bancale, j'ai été touché, j'ai ri et j'ai chialé. Peut-être que c'est un bon début ?
La très talentueuse Ache nous a offert une excellente vidéo en ce début d'année sur le capitalisme et comment tenter de changer les choses. Écriture, réalisation, montage, justesse du propos, tout y est. Et c'est un bon point de départ pour s'initier au sujet, ou l'approfondir, ou se sentir un peu moins seul·e.
Usant des codes des réseaux sociaux et des diffusions virales, Sushi démonte avec humour et un brin de sarcasme les idées fausses, stupides voire nuisibles qui y sont parfois véhiculées. Je trouve ça astucieux, bien fait malgré l'apparence d'un truc à l'arrache, et d'une certaine fraîcheur quant à la catégorie hautement glissante du débunkage.
Très court-métrage que je vous laisse le plaisir de découvrir ici.
Beaucoup de musiques que j'arrive à entendre, aussi pour étouffer un peu mes acouphènes permanents, donc dans l'absolu pas forcément des trucs incroyab', mais surtout des podcasts. Et en particulier ceux d'ANTICOR. C'est un petit plaisir malsain, je dois l'admettre, mais ça me passionne sur bien des points. Et c'est bien écrit et bien dit, avec un petit côté hypnotisant façon ASMR, idéal dans un RER archi bondé à l'heure de pointe.
Janvier a été misérable de ce côté. Quelques articles de presse et dossiers, essentiellement axés sur la politique, rien que je souhaite partager ici. Il y a deux-trois bouquins prêtés mais jamais rendus que j'essaie de retrouver pour m'y remettre doucement, mais pour moi, ça nécessite une quiétude que je n'ai pas retrouvé.
Ça va vous paraître chiant comme la mort, mais je bosse pas mal en ce moment le LMS Moodle. Déjà parce-que j'en ai besoin, ensuite parce-qu'il n'y a pas de savoirs inutiles. Pour ça, je picore à droite à gauche ce que je trouve, j'écoute, je regarde, je lis. La partie tech m'intéresse très moyennement, mais la partie pédagogique offre des perspectives passionnantes.
Je brode depuis tout gosse. Et pour diverses raisons, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Je pensais savoir à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, alors que pas du tout. Je découvre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Là aussi, je pioche un peu partout et j'admire la maîtrise de certaines personnes. Si vous êtes sages, je vous montrerai une broderie en cours que j'ai sous le coude et sur laquelle je bosse depuis 2018. Oui.
J'ai toujours été fâché avec les maths (coucou Madame Charneau). Mais j'essaie de me réconcilier progressivement. Ça a commencé avec la chaîne Micmtahs, excellente de pédagogie. Je recommande d'ailleurs son bouquin Le Grand Roman des Maths, qui constitue l'un des plus beaux voyages au pays des sciences que j'ai eu l'occasion de faire.
Voilou. si vous êtes arrivé·e jusque là, félicitation et merci de m'avoir lu. :)
from Une vague idée du monde...
Ah ton rire… le monde devient immense, chaud et joyeux. On a tellement ri que tu t’ais fait pipi dessus. Rien du tout, une petite goutte. Alors quels pleurs, quelles larmes… Tu étais honteux malgré nos mots qui se voulaient réconfortant, minimisant. Ta mère devait être partagée entre culpabilité et agacement. Les pleurs, les cris sont toujours aussi difficiles pour elle. Et puis l’incompréhension… comme si tu avais déjà toute l’expérience nécessaire pour comprendre que … pour comprendre quoi d’ailleurs. Tu éprouvais de la honte. Tu aimerais ne jamais faire de bêtises. Tu voudrais tout savoir et tout savoir faire parfaitement. Nos mots n’y peuvent rien. Alors je ne te lâche pas mon grand, je transforme mes mots-explication en mots-bouées, en mots-perches, en mots-liens, en mots qui tissent un je-ne-sais-quoi qui nous relient sans crainte et sans attente. Après la douche, je te passe de la crème pour hydrater ta peau toute sèche, « peau atopique », pas typique. Avant même que je ne te touche, tu te tortilles, tu rigole de chatouille et ton corps se tend. Alors je pose une main sur ton dos, je ne bouge pas et je t’invite avec les mots à écouter ce que tu ressens, plutôt que cette anticipation. Tu te détends, je crois même que ça te fait du bien. Alors je tartine et, ô malheur ! je passe sur ta main. Tes larmes reviennent, tu détournes le regard… « berk… je ne pourrais plus toucher ma radio ! ». Je te comprends, je me rappelle ses sensations, moi aussi quand j’étais enfant. Tu l’exprimes si bien. Incompréhensible ou insupportable pour d’autres peut-être. Pour moi ce serait injuste, violent que je le dénigre. C’est facile pour moi d’accueillir. Je souris à l’intérieur, c’est chaud. Je t’invite à rester ici et maintenant. Il n’y a pas la radio. On n’est même pas encore à l’enfilage du pyjama. Tu n’aimes pas la sensation d’avoir les mains grasses. Ok. Tout à l’heure on se lavera les mains ensemble. Tu verras. On a continué, et tu n’as pas fait de crise (je n’aime pas cette formule, comme s’il le faisait exprès, pour embêter, …). Je t’ai accompagné, tout en te laissant ton autonomie, si importante pour toi.
Après l’histoire, après que je t’ai dit « bonne nuit, je t’aime fort », tu as demandé ta radio à maman et puis tu t’es endormi.
from F & M
Je viens chez maman.
La télé tourne.
Et je suis dégoûté.
On ne sait plus où finit le programme et où commence la pub.
Pubs en rafales, destruction massive du cerveau, annihilation douce et insistante.
Le volume monte au bon moment, pile quand la pub éclate, pour que le cerveau sursaute et que l’œil reste collé.
Propagande, tampons, déodorants, caries, sourires béats, images qui frappent là où les mots ne suffisent plus.
Séries sans fin, programmes creux, bruit, fureur, rien que bruit.
Tout pour que tu restes éveillé pour la pub.
Pour que tes yeux suivent, que ton esprit se laisse happer.
Pour que tu consommes, que tu avales, que tu encaisses.
Dégoûté.
from Depuis les Gorces
#Ecologie #Numérique #IA En ce moment je discute pas mal d'IA avec des personnes écolos, mais dont je ne partage pas complètement l'avis. C'est intéressant, car ça me permet de découvrir des arguments pro-IA, et d'y réfléchir... Listes d'arguments et de réponse qui sera actualisée au fur et à mesure de nos échanges... Depuis quelques semaines, j'entends donc plein d'arguments originaux. Je dis originaux, parce que d'habitude j'entends parler d'IA sur mastodon, et que dans ma bulle informationnelle, je n'entends jamais d'arguments pro IA... J'ai beau savoir que la meilleure manière de convaincre quelqu'un c'est de l'écouter, j'ai toujours envie de répondre.
Mais intellectuellement, je déteste rester avec un argument qui m'a coincée. Et puis en plus, prochainement, je vais peut être devoir défendre ma position dans un débat, et là pour le coup, c'est utile d'avoir anticipé des arguments à opposer aux pro-IA.
Mes discussions récentes m'ont surprises. Mes copaines sont au courant des dégâts de l'IA, mais pour autant iels défendent qu'on utilise de l'argent public pour développer une IA générative souveraine, avec du code ouvert et pour les bons usages.
Et comme c'est comme le smartphone, qu'on n'a plus le choix que de l'utiliser, alors il faudrait avoir une alternative.
Je n'ai pas réussi à percuter sur le coup, mais l'analogie avec le smartphone ne va pas.
On prend souvent comme exemples le smartphone ou la voiture pour illustrer des verrouillages technosociétaux : il est quasiment impossible de faire sans.
Mais ce n'est pas le cas de l'IA gen à cette échelle. Oui pour certaines personnes dans certains emplois ça devient très difficile de s'en passer individuellement (risque de perdre une promotion ou de ne pas avoir son contrat renouvelé), mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes.
Là, j'ai l'impression de devoir m'opposer à des gens de droite qui défendent les grosses entreprises...
Nos avis divergeaient aussi sur l'IA et l'éducation. Tout le monde dans le groupe semble convaincu qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour enseigner (c'est déjà ça), mais certain·es pensent qu'il faut apprendre aux enfant à utiliser l'IA.
Je range ces arguments comme pro IA avec de l'argent public puisque les enseignant·es sont payés avec de l'argent public.
Au cours des discussions, l'argument à pivoter de développer une IA souveraine à développer des infrastructures pour faire de l'IA chez nous. On parle donc de développer des datacenter pour faire de l'IA. À quel moment on se dit que c'est une bonne idée de construire des usines qui ne créent pas d'emplois directs, qui consomment en local énormément d'eau et d'énergie, et qui demandent une grosse activité minière ?!
from tradjincal
I have to write something on workspace in browser. Popularized by Arc browser I think, other browsers re-implement the idea, mainly Zen browser and Vivaldi.
The main idea is to group tabs it a workspace. If like me you have 100+ tabs open, you can thinks it will help you to manage it, at least it was that I though at first (spoiler no). I tested only Vivaldi and Zen browser but I have the same problem in both even if both browser have their own specific feature.
Lets describe my usecase. I am not an only keyboard user, I don't have tiling windows manager, but, I use some keyboard shortcut. I have 27” monitor at work and 34” (21:9) monitor at home. I like to have 1 windows full size or 2 side to side. I use the same shortcut on both windows and kde : – alt + tab to switch windows – super + up to maximize windows – super + left or right to tile the current windows on left or right (take the half of the monitor – super + shift + left or right to move windows on another monitor
I enough for me and if i need specific management, I use my mouse.
To manage my tabs, I use to create 1 or 2 windows, one with mainly Youtube video, the other with other stuff (code or personal stuff). I can switch from one to the other by using alt + tab and i can have 1 windows next to another using previously described shortcut.
The only problem is have to much tabs open because I let them open “just in case”
I tried to move on workspace, I try both Vivaldi and Zen browser. I create some space 1st. Lets took the example of work: – 1st space will be video (easy, I have already a dedicated windows for that) – 2nd here is the trick, I can just create a “work” space but I think it does not change anything, so I created 1 group by programming language (python and go in my case) and 1 group for business application.
Now the first problem I have is before to open a new link, I have to check in which space I am. In Vivaldi you can move automatically tabs in space according the URL not in Zen.
Then, you want to switch from to the other using shortcut (but it is the same problem with mouse). So you have to switch on the browser windows with one shortcut then selecting the correct space with another shortcut (2 operations).
So I finish to created 2 windows, with 1 different space opened in each. Zen does not manage well this case, the same space cannot be open on different window so you end up open tabs in the same space but different windows and to re-find it, good luck. With Vivaldi it is a bit better for space you created (you can open it in different windows and retrieve all tabs it contains) but not for the default one.
It also do not help to close tidy my tabs and I even less motivate to do it because where do I start.
In conclusion, it adds an additional layer (at least for me) of management which is not always practical. I end up to not use them. In Vivaldi, I deactivated them completely and I switch back on Firefox. It remains me the statement of suckless programs which is to let windows manager or terminal multiplexer manage things: > Do not re-implement tmux and his comrades. Apply to browser it became do not re-implement windows manager feature
#browser, #firefox, #zenbrowser
from Une vague idée du monde...
Pas de bain hier Pourtant c’était dimanche Un si grand malheur
Sèche tes larmes Ce soir tu f’ras le crocodil’ Avec maman ta complice
from irisdessine
from F & M
Sur l’application Kiff Market, il fait défiler les images. La caméra du smartphone suit, attentive, son regard, à l’affût d’un signe dans ses pupilles ou son fond d’œil. Puis il se dirige vers le sas d’entrée de son appartement. Le sas est vide. Il ne trouve pas l’objet qui a activé sa convoitise sur le site. Décidément, leur slogan – sitôt kiffé, sitôt livré – ne marche pas.
from Ma vie sans lui
Accepter (?)
Le mot a été prononcé plusieurs fois, par moi, par la psy. Je crois que je commence à entrer dans cette portion du chemin de deuil qu'on appelle l'acceptation. Oui, mon amoureux est mort, c'est arrivé et c'est terrible, cela fait toujours aussi mal mais c'est arrivé et on ne reviendra jamais en arrière, il me faut apprendre à vivre avec ce manque de lui.
J'imaginais cette période d'acceptation comme un sentier bien balisé, relativement plat, où les aspérités sont petit à petit gommées et où l'on commence à revoir loin à l'horizon. J'étais bien naïve... Il y a encore de sacrés obstacles au milieu de la route, des dénivelés plus raisonnables mais qui cassent encore les pattes par moments et quant à l'horizon, il est souvent bien bouché.
J'imaginais aussi que cela ferait moins mal mais je vis définitivement au pays des Bisounours dans ma tête : le manque de lui fait toujours un mal de chien et ce n'est pas près de s'arrêter.
J'ai parcouru dernièrement des bribes de notre histoire, un peu par hasard et un peu aussi pour tester ma résistance à la douleur de la perte (je fais ça, de temps en temps, histoire de voir où j'en suis de cette fichue route du deuil). Je pleure moins, je souris même parfois des souvenirs ce que nous avons vécu ensemble mais tout de même, je suis forcée de constater que la plupart du temps, j'ai le souffle coupé de douleur.
Tout le monde me dit que c'est encore trop frais, que c'est normal. D'accord, ça aussi, je l'accepte. A vrai dire, je suis tellement lessivée par tout ça que je suis prête à tout accepter, à condition que cela ne me fasse plus mal.
Notre histoire a été courte (4 ans) mais d'une intensité exceptionnelle, je le mesure en relisant nos échanges, en repensant à notre vie à deux. Nous avons eu une chance inouïe de pouvoir vivre un amour pareil, que des millions de gens ne le connaitront jamais. Ces 4 années ont bouleversé durablement ma vie entière, elles m'ont changée, m'ont apporté plus que les 30 précédentes. Alors passer en 10 min d'un amour aussi extraordinaire à plus rien du tout, c'est une épreuve intense, elle aussi. J'imagine que c'est un joli caillou dans mes chaussures, pour avancer.
Il ne sera plus jamais là, je veux bien l'accepter (ai-je bien le choix, d'ailleurs ?) mais je me demande tout de même : cela veut-il dire aussi que je dois accepter d'avoir le coeur gelé en permanence, les sourires tristes et la colère prompte, le ras-le-bol généralisé d'une existence sans relief, la solitude, même, cette nouvelle compagne que j'ai du mal à apprivoiser ? Et surtout, surtout, le pire, cela signifie-t-il que je dois accepter de ne plus être aimée de lui ? (parce que ça, je crois que je n'y arriverai jamais...)
from Depuis les Gorces
#Politique #Ecologie Un copain me posait récemment la question, et j'avais dit que je prendrais le temps d'y répondre. On est vendredi soir, je viens de recevoir un mail chasse au sorcière du bureau politique, c'est le bon moment pour y répondre.
J'ai adhéré en 2022, en début d'année. J'avais l'impression d'être allé au bout de la démarche des petits gestes, d'avoir pas mal d'éco-anxiété, et je lisais partout qu'il fallait s'engager collectivement. J'ai donc adhéré à un syndicat et à un parti. Je cherchais un parti de gauche, écolo, et qui traite des questions de sexisme et de VSS, j'ai donc choisi EELV.
Je n'avais pas prévu de m'engager, juste de soutenir en payant ma cotisation. Et puis il y a eu le tourbillon des législatives, et puis j'ai eu l'impression que je pourrais être utile dans le groupe local. Et puis on m'a proposé de faire partie d'une liste pour le congrès des verts, et j'ai été élue conseillère fédérale.
Honnêtement, je sais pas. J'ai eu l'impression de laisser beaucoup de points de vie dans cette histoire pour pas beaucoup d'impact. Je prends le temps de ce billet pour faire un bilan, calmement, toussa.
Les dynamiques de groupe sont partout compliquées. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'intégrer sur mon temps libre des groupes dysfonctionnels et d'être celle qui doit manger son chapeau pour laisser les dominant·es ne pas se poser de questions. Que ce soit au local, ou dans notre courant, je n'ai pas trouvé de cadre réellement bienveillant. Tout le monde a ce mot à la bouche, mais dans les faits, c'est autre chose.
Je me suis posée beaucoup de questions sur moi, et si j'étais trop ceci ou trop cela. Mais dans le cadre de mon travail, je n'ai aucune difficulté relationnelles. Et dans le cadre bénévole, j'ai mené deux projets (la création de l'association Sciences Équines ou le projet Maths4Sciences) qui étaient des petits bonheurs humains. Donc je ne pense pas être le problème, mais oui, je suis probablement trop sensible pour beaucoup de collectifs où il faut prendre quelques coups avec le sourire.
Le plus positif de cette histoire, c'est que j'ai appris plein de choses sur l'écologie politique.
Les chiffres ne sont pas bons. Je pense que ça m'a beaucoup plus coûté que ça ne m'a apporté en moments de qualité ou en sentiment d'utilité générale.
Déjà, parce qu'en candidatant pour le conseil fédéral, je me suis engagée à tenir un mandat, donc 3 ans. Et si je démissionne, ma place part à un autre courant, donc c'est pas terrible.
Ensuite, j'ai récemment intégré une commission (numérique), et le bureau se monte, j'en fais partie, et j'ai l'impression qu'on peut y avoir une dynamique saine et faire quelques trucs : porter une ou deux motions, organiser un ou deux webinaires de sensibilisation, peut-être même monter une formation.
J'ai donc ré-adhéré même si le bureau politique, et beaucoup d'autres personnes avec lesquelles je suis sensée partager beaucoup de valeurs, me déçoivent énormément. Mais j'ai pris la décision de me protéger davantage en limitant le nombre de réunions et en m'éloignant des collectifs dysfonctionnels.
Cette année j'espère rencontrer de nouvelles chouettes personnes et faire un bout de chemin avec celles déjà rencontrées. Et j'ai l'impression que comme j'ai davantage compris comment ça marche, je vais pouvoir centrer mon énergie là où elle sera plus utile. Ce ne sera pas de la grande utilité qui change le monde ni le quotidien de personnes autour de moi, mais je pense :
Et ce sera ma petite pierre à l'édifice.
from tradjincal
Cela fait 6 mois maintenant que je suis passé entièrement sur linux, une kubuntu pour ma part. Une grosse part de mon utilisation est les jeux vidéo et avec steam et heroic launcher, j'étais pleinement satisfait. Le seul point que je n'avais pas encore réglé, c'était de pouvoir changer de disposition de clavier (d’azerty à qwerty) car certains jeux le gère mal (hein cyberpunk) voir pas du tout.
Sur windows, j'avais le raccourci clavier shift+alt pour changer en qwerty et pas de problème. Sous linux (en tout cas kubuntu wayland), j'ai le même raccourci qui fonctionne très bien sous kubuntu mais pas dans wine.
Je commence par la fin pour les plus impatients, la méthode que j'ai trouvée est de faire un setxkbmap us . On se retrouve avec un beau warning sous Wayland, mais ca affect bien les jeux sous wine
$ setxkbmap us
WARNING: Running setxkbmap against an Xwayland server
Pour automatiser tout ça, j'ai fait 2 petits scripts que je vais donner à heroic launcher. Pour passer en qwerty:
#!/usr/bin/env bash
setxkbmap us
Pour passer en azerty:
#!/usr/bin/env bash
setxkbmap fr
Pour les non programmeurs, voici les commandes à donner pour créer les 2 fichiers
mkdir -p ~/scripts
echo -e '#!'"/usr/bin/env\nsetxkbmap us" > ~/scripts/set_us_kbd_x11_wine.sh
echo -e '#!'"/usr/bin/env\nsetxkbmap us" > ~/scripts/set_fr_kbd_x11_wine.sh
chmod +x ~/scripts/set_us_kbd_x11_wine.sh
chmod +x ~/scripts/set_fr_kbd_x11_wine.sh
Et maintenant dans heroic, il faut aller: – soit, pour un jeu, dans settings (du jeu) → advanced – soit, pour tous les jeux, dans settings (global) → game defaults → advanced
et pointer pour les options “Select a script to run before the game is launched” et “Select a script to run after the game exits” sur les scripts dans le répertoire scripts de votre dossier user sur les scripts respectifs set_us_kbd_x11_wine.sh et set_fr_kbd_x11_wine.sh
J'ai essayé plusieurs choses avant d'arriver à ça, qui n'est sûrement pas la solution la plus propre.
LC_ALL =en_US.UTF-8Ces 2 solutions ne fonctionnent pas.
La dernière méthode est de supprimer toutes les dispositions claviers sauf le qwerty dans les paramètres système mais ce n'est tout bonnement pas pratique.
En espérant que ça puisse aider d'autres personnes #jeuxvideo
from Un Spicilège
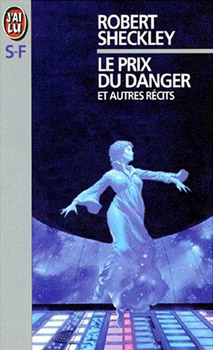
J’ai trouvé Le prix du danger un peu par hasard, dans une librairie d’occasion, tout de suite attirée par sa couverture qui reprend l’affiche du film d’Yves Boisset. Impossible d'oublier ce visuel qui m'a rappelé un très bon souvenir de cinéma. J'ai bien évidemment voulu découvrir l’œuvre originale dont il a été tiré. Très bonne décision de ma part tant ce recueil de neuf nouvelles fut jubilatoire à lire !
Dès la première nouvelle, Le prix du danger, Sheckley frappe fort. Au-delà de la grande affection que j'ai pour son adaptation cinématographique de 1983, j’ai pris un réel plaisir à retrouver cette histoire sous sa forme originale. Le film de Boisset (porté notamment par un Michel Piccoli absolument génial, sans oublier Marie-France Pisier et Gérard Lanvin) avait marqué la jeune adulte que j'étais par son regard acerbe sur le pouvoir. Pendant ma lecture, il m'est apparu clairement que le cinéaste a su capter l’essence même du texte : la critique mordante d'un système truqué, dans lequel les puissants finissent toujours par gagner. Un propos magnifié par le cinéma politique de Boisset, qui a su donner toute sa puissance à un texte tout en ironie. Je digresse un peu : en revoyant le film récemment (il est disponible sur Arte et je ne peux qu'en conseiller le visionnage !), j’ai reconnu dans les premières minutes les Espaces d’Abraxas à Noisy-le-Grand, un ensemble architectural que je côtoie de près et que j'adore, toujours prêt à servir de décor à des futurs dystopiques !
Pour en revenir au livre, il serait toutefois très réducteur de ne s’attarder que sur cette première nouvelle. En effet, l’ensemble du recueil fait preuve d’une qualité et d'une inventivité remarquables. La clé laxienne et Permis de maraude, par exemple, sont des textes d'une drôlerie absurde particulièrement réjouissante. Sheckley excelle vraiment dans l’art de pousser une idée jusqu’à ses conséquences les plus improbables, révélant de fait l’absurdité de certaines de nos actions.
Malgré l’époque de leur écriture (les années 50), la plupart des nouvelles n’ont rien de désuet. Le style reste vif, direct, provocateur, et surtout empli d'un humour acerbe et cruel. Les thèmes abordés, notamment la défiance envers les nouvelles technologies et les dangers d’un progrès mal maîtrisé, restent parfaitement d'actualité. Le recueil interroge sans cesse notre rapport au pouvoir et notre propension à accepter certains systèmes sans même se poser de questions. Évidemment on ne peut passer à côté d'un certain virilisme et d'une vision des femmes parfois un peu datée comme dans Un billet pour Tranaï. Cependant, au-delà du fait que cela s'explique parfaitement par une remise en contexte, on se rend vite compte que cela n'empêche pas l'auteur de faire preuve d'une certaine modernité sur le sujet.
Le prix du danger est donc un recueil brillant, drôle et incisif. Une très très bonne surprise que je recommande chaleureusement aux amateurs et amatrices de science-fiction qui aiment en retracer l'histoire. Si vous avez la chance de tomber dessus en occasion, ne passez pas à côté !
Le prix du danger | Robert Sheckley | J'ai Lu